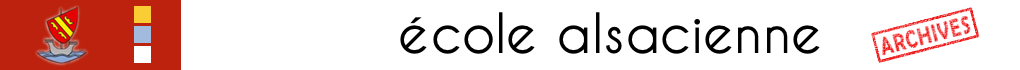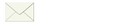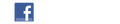Sommaire
Recherche
Connexion
Le film qui a regardé notre enfance
Le film qui a regardé notre enfance
À l’occasion de la Semaine du cinéma 2011
Mêlant musique, arts plastiques, théâtre et extraits de film, le spectacle met en scène les souvenirs de quelques élèves et enseignants du film qui avait le plus marqué leur enfance ou leur adolescence.
L’idée de ce spectacle est née d’une rencontre au théâtre du Rond-Point avec le travail de Serge Dridy et de Nicolas Bouchaud à partir de la parole de Serge Daney, sorte de longue, profonde et sinueuse réflexion sur le cinéma. Au sortir de cette représentation, l’enthousiasme de nos élèves d’options, le nôtre, notre conscience d’avoir assisté à un moment de grâce inouï, où le théâtre se marie avec le cinéma, nous avons immédiatement cherché à leur donner un prolongement.
Une phrase que Serge Daney emprunte à Jean-Louis Schefer avait attiré particulièrement notre attention, une formule poétique à souhait, celle de l’intelligence qui fascine : « le film qui a regardé mon enfance » disait-il à propos de « Rio Bravo », dont il confiait l’importance dans son rapport viscéral au cinéma, la constitution de son être au monde.
Le cheminement qui s’ensuivit est simple à deviner : il suffisait de partir de cette perspective si justement paradoxale, de proposer aux collègues, aux élèves, d’écrire un texte sur cette thématique, de se doter ainsi d’une matière à jouer pour nos élèves.
L’entreprise rencontre rapidement un vif succès, l’idée séduit, nombre de personnes se prêtent au jeu de sorte que nous nous retrouvons rapidement avec quelques joyaux. Le défi est de taille, mais il est bel et bien lancé, au-delà de nos espérances. Nos imaginaires complices se mettent en branle, l’état de rêverie est en marche et nous nous projetons le film du spectacle à venir.
Les élèves de théâtre s’emparent des textes, les apprennent avec le cœur, nous imaginons rapidement une dramaturgie à partir de ce qui nous a été donné. Sophie-Anne Lecesne, comédienne et intervenante à l’option théâtre, enthousiasmée par le projet retrousse ses manches, Dominique Deplus, notre éternelle complice fait travailler ses talentueux musiciens, ses chanteuses ; Gaël le Bosser lancent ses élèves d’Arts plastiques dans la réalisation d’affiches-portraits , ceux de cinéma travaillent à des courts-métrages ( consultables en ligne sur le site de l’École ). Enfin, ce à quoi nous avions rêvé, grâce à l’énergie de tous les participants, à leur talent précieux, est advenu.
L’obsession de la convergence des arts, réunir les savoirs-faire artistiques multiples, tisser des liens entre des individualités aux goûts divers, créer l’occasion d’une rencontre entre des élèves qui se croisent souvent dans l’enceinte scolaire sans se regarder, les ré-unir dans un espace sacré indispensable, la scène, lieu d’une communion avec le public, vivre ce bonheur simple d’être ensemble au service d’une création collective. Partager des souvenirs, des images, de la musique, des mots, une culture commune qui fait notre cohésion, notre force, le plaisir d’être là, « hic et nunc », la satisfaction d’un travail accompli. Jouer, donner, adresser, le temps d’une éphémère soirée rythmée par les souffles, les silences, les rires de ceux qui étaient venus voir cet hommage au cinéma par le théâtre ou cette célébration du théâtre par le cinéma, c’est comme voudrez…
G. Perrin et R. Sack
La mélodie du bonheur et moi
(Laurence Letourneux)
 Cela commence avec le souvenir d’un lieu d’antan. Grandiose et désuet.
Cela commence avec le souvenir d’un lieu d’antan. Grandiose et désuet.
Ma mère (elle s’appelle Francine, vous le croyez ?) m’a emmenée dans un cinéma qui ressemblait à un vieux théâtre, avec du velours, des loges, des étages et des balcons, toute une atmosphère feutrée et chic. Il me semble que c’était le Grand Pavois, tout est dans le nom.
Je crois qu’au milieu du film qui est long, il y a eu un entracte, comme au théâtre ou à l’opéra, et j’ai mangé un cône glacé… C’était une sortie exceptionnelle.
Le grand écran s’ouvre sur un décor autrichien, sur une musique autrichienne, des montagnes, des edelweiss, des nuages au-dessus d’un village folklorique, et une très belle maison nichée dans ce paysage somptueux qui fait décoller de son siège.
Tralalaïdi tralalaïdi…
Moi, j’aimais déjà les histoires romantiques, Mary Poppins, et je voulais être maîtresse. Je m’entraînais avec mes poupées alignées sur mon lit, mon frère docile au milieu acceptant mes dictées et mes petits cahiers de notes, et moi devant le grand tableau noir que mon père, professeur de mathématiques lui-même, m’avait légué… Vous voyez, je ne pouvais qu’adorer cette Miss Julie Andrews qui débarquait dans une imposante famille autrichienne pour réformer les méthodes éducatives d’un père trop sévère, se faire aimer de sept enfants classés par ordre de taille devant l’escalier, leur apprendre à chanter et à aimer la vie.
La vie, c’est pas réciter des leçons qui ennuient. La vie, c’est pas aller se coucher tôt. La vie, c’est pas obéir froidement. La vie, c’est pas être toujours sage.
Julie Andrews dans le film, elle vient avec sa guitare, se grande jupe, ses cheveux courts… Elle est libre. Moi, j’adorais sa façon franche de regarder le père qui peu à peu tombe amoureux de celle qu’il trouve trop excentrique, j’adorais sa voix, sa petite coupe garçonne et son enthousiasme pour tout ! Toujours pour elle tout devient prétexte à s’amuser, à apprendre, à créer.
Et c’est le moment du DO…
Do, le do il a bon dos Ré rayon de soleil d’or Mi c’est la moitié d’un tout Fa c’est facile à chanter… ça ne s’arrête pas c’est la ritournelle du bonheur c’est la clé : avec une toute petite chose au départ, presque rien, une note toute seule qui n’a l’air de pas grand-chose, on se met à inventer, on trouve, on ajoute, on compose et à la fin c’est beau !
Moi, je me serais damnée pour cette chanson et cette leçon de musique : en plus, c’est en courant avec tous les enfants dans l’herbe, en sautant des ruisseaux sous le soleil, et puis il y a le grand fils qui est assez charmant, et l’aînée de la famille toute jolie… Je ne sais pas qui je suis mais cette énergie de Julie Andrews avec sa voix claire claire et son sourire ouvert ouvert, c’est un grand bonheur.
A la maison on avait le 33 tours et on l’écoutait. J’aimais bien aussi la chanson du coucher Ding Dong et tous les enfants remontent le grand escalier un à un. Cette arithmétique familiale, cet ordre qui était subi et qui devient choisi, la leçon de mademoiselle.
Une éternelle mademoiselle… elle vole de maison en maison avec sa grande jupe pour atterrir en douceur, et plein d’enfants lui font des signes avec les bras pour lui dire « Viens viens on veut la leçon, on veut La Leçon ! »
Alors c’est Do le do il a bon dos… Formule magique pour tous les âges et tous les naïfs.
C’est vrai que c’est trop simple.
Mais Julie Andrews dit que ça suffit, alors c’est la vérité.
C’est le bonheur de la mélodie.
Les choses de ma vie
(Alice Pichard)
 A la dérobée, j’ai vu « Les choses de la vie » de Claude Sautet. Dans l’embrasure de la porte, puis, lorsque la vigilance parentale se fut diluée, plus près de l’écran, plus près des visages, plus près de ces « choses » de la « vie », si mystérieusement attirantes parce que si radicalement éloignées de ma vie à moi ce soir là.
A la dérobée, j’ai vu « Les choses de la vie » de Claude Sautet. Dans l’embrasure de la porte, puis, lorsque la vigilance parentale se fut diluée, plus près de l’écran, plus près des visages, plus près de ces « choses » de la « vie », si mystérieusement attirantes parce que si radicalement éloignées de ma vie à moi ce soir là.
Ma vie alors était une vie d’enfant lisant les aventures du Général Dourakine, dans un lit à une place, dans une chambre silencieuse, dans un pays lointain, dans les années quatre-vingt. Ma vie alors était indubitablement autre, loin de cette « vie » qui se déroulait sur l’écran, fictive et filmée, mais si attirante car si exotique et porteuse de promesses.
Le baiser dans le cou tiède et encore plein de sommeil, et le baiser attendu qui ne vient jamais ; aimer immédiatement, au milieu d’une salle des ventes de l’île de Ré, et aimer ensuite sans jamais être vraiment rassasié, sans jamais se sentir pleinement aimé en retour, du moins pas comme on l’attendrait ; ce qu’on construit, ces pièces, ces photographies, ces enfants, ces rires, ces silences, et le dernier instant qui décompose ces moments en milliers de fragments, réfléchis par les flots qui se referment. Toutes ces « choses », je comprenais malgré moi qu’elles constituaient ce que le monde qui m’était encore refusé nommait la « vie ». Grâce et fragilité.
Et puis, bien sûr, cette fascination qui ne mourra jamais pour Romy. Longtemps, j’ai séparé mes cheveux par une raie médiane, et les premières lunettes que je choisis pour voir un peu plus clair dans l’opacité du monde furent l’exacte réplique des siennes ( large monture en écaille, légèrement ridicule sur une élève de sixième un peu gauche et complexée). Par la suite, j’ai vu tous ses films et me suis entraînée à prononcer « Da-avid ». J’ai chéri la Romy en moi, cherchant le reflet de la ligne de sa nuque devant glaces et vitres d’autobus.
Confusément sans doute, devant le film de Sautet, je renonçais une fois pour toute à l’imagerie de la Bibliothèque rose ; l’histoire d’une femme, qui aime un homme plus vieux, avec un passé, une ancienne épouse, un enfant, une vie déjà constituée. Ce qu’il leur reste à construire : le jour. L’aurore. Le rayon de soleil sur la terrasse. Rien. Tout. Et ce tout m’intriguait et nourrissait ce qui deviendrait, un jour, peut-être, ma vie.
Chacune de ces « choses » me semblait éloignée de mon univers : une époque à laquelle je n’étais pas encore née ! La France, et Paris, et des routes qui se croisent, alors que chacun de mes pas était soigneusement guidé et protégé des forces fatales ! La tendresse amoureuse, vue de biais, comme ce plan qui présente Romy et Michel sur la terrasse, vus de la fenêtre qui donne sur l’escalier… Visions cachées, dévoilées, fragmentées, qui ont nourri l’espoir d’avoir, à mon tour, des « choses » pour, l’espace d’un (ultime) instant, constituer le film de ma « vie ».
Ce qui me reste
(Jean-Luc Lemaire)
 Ce qui me reste d’Un monde sans pitié, c’est une certaine physiologie de la marche. Dès le générique, Hippo (Hippolyte Girardot ), trentenaire oisif à veste légère arpente le macadam parisien d’un pas alerte en n’omettant pas de se retourner sur celles qu’il a défié du regard. Chacun de ses pas semble l’éloigner toujours plus des grandes illusions sociales : la religion, le travail, le vingtième siècle et ses idéologies, l’avenir technocratique... Sa démarche n’est pas celle d’Halpern (Yvan Attal), son meilleur ami et frère de désillusions - qui lui emprunte le chemin de la larve, ni le mouvement pressé de son coup de foudre amoureux joué par Mireille Perrier (actrice sans grand intérêt, admettons-le au passage, la plus charmante étant l’amie du petit frère dealer rencontrée dans la cuisine ) obnubilée par son parcours ascendant, trop ascendant, de normalienne-traductrice. C’est encore moins la foulée volontaire de son ex, Francine, la rabat-joie dont les sentences morales trahissent une trajectoire de morte-vivante exemplaire. Hippo est bien le seul à savoir évoluer comme un vivant dans une ville de fantômes voués soit aux fêtes soit au labeur, et je lui serai toujours gré de m’avoir imposé avec d’autres sources plus littéraires une certaine exigence existentielle en la matière.
Ce qui me reste d’Un monde sans pitié, c’est une certaine physiologie de la marche. Dès le générique, Hippo (Hippolyte Girardot ), trentenaire oisif à veste légère arpente le macadam parisien d’un pas alerte en n’omettant pas de se retourner sur celles qu’il a défié du regard. Chacun de ses pas semble l’éloigner toujours plus des grandes illusions sociales : la religion, le travail, le vingtième siècle et ses idéologies, l’avenir technocratique... Sa démarche n’est pas celle d’Halpern (Yvan Attal), son meilleur ami et frère de désillusions - qui lui emprunte le chemin de la larve, ni le mouvement pressé de son coup de foudre amoureux joué par Mireille Perrier (actrice sans grand intérêt, admettons-le au passage, la plus charmante étant l’amie du petit frère dealer rencontrée dans la cuisine ) obnubilée par son parcours ascendant, trop ascendant, de normalienne-traductrice. C’est encore moins la foulée volontaire de son ex, Francine, la rabat-joie dont les sentences morales trahissent une trajectoire de morte-vivante exemplaire. Hippo est bien le seul à savoir évoluer comme un vivant dans une ville de fantômes voués soit aux fêtes soit au labeur, et je lui serai toujours gré de m’avoir imposé avec d’autres sources plus littéraires une certaine exigence existentielle en la matière.
Depuis, je règle mes humeurs sur mon pas, et non l’inverse. Je me souviens même avoir marché avec cette légèreté souveraine vers une université inconnue. J’étais alors décidé à retrouver le nom d’une fille sur des listings administratifs, comme dans la scène où Hippo rétorque à une employée outrée par sa requête : « Et alors, vous n’avez jamais été amoureuse ? »
Entre deux avenues, au sortir d’un square ou à l’arrêt de bus, je me surprends encore à fredonner le refrain un peu daté du générique. Même si j’ai depuis tué le dandy en moi, lorsque le rude climat parisien se fait plus clément, des bouffées d’insouciance devenues si rares remontent parfois, et je les apprécie avec d’autant plus de délectation.
Le regard d’Ali Mc Graw
(Richard Sack)
Le film qui a regardé mon enfance, le film qui a regardé mon enfance… c’est une belle image, non ?…Elle oblige à changer de perspective. Terrible aussi… parce qu’elle interroge de lointains souvenirs, perdus dans les limbes diffuses d’un passé qui ne m’appartient plus. Il faut donc se mettre en état d’errance, en état de rêverie pour faire apparaître les images qui sommeillent hors de moi et en moi…les extirper de l’écrin d’or qui les protège... Moteur !
Le film qui a regardé mon enfance, le film qui a regardé mon enfance… Ne vous fiez pas aux apparences, je ne cherche pas, je trouve, Picasso disait ça... J’y suis... « Love Story » !
[Musique du film]
Waouh ! nous vivons dans un monde formidable, on prononce les mots magiques et la musique surgit de nulle part (enfin mille excuses à la régie…) Ca, c’est la musique du film…tout le monde l’a entendue un jour, un standard classé patrimoine de l’humanité…même ceux qui n’ont pas vu le film connaissent la mélodie.
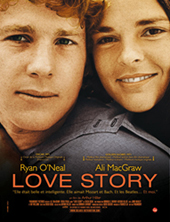 La sortie du film, c’est 1970 et c’est en 74 que je vais, avec une camarade au cinéma pour la seconde fois. Nous ne savons pas vraiment ce que nous allons voir, nous sommes à peine sortis de l’enfance, nous vivons dans une petite ville de province et il n’y a qu’une salle de cinéma…nous savons que c’est un film d’amour, c’est suffisant, l’amour nous regarde évidemment…et nous ne serons pas déçus…
La sortie du film, c’est 1970 et c’est en 74 que je vais, avec une camarade au cinéma pour la seconde fois. Nous ne savons pas vraiment ce que nous allons voir, nous sommes à peine sortis de l’enfance, nous vivons dans une petite ville de province et il n’y a qu’une salle de cinéma…nous savons que c’est un film d’amour, c’est suffisant, l’amour nous regarde évidemment…et nous ne serons pas déçus…
Deux images m’ont accompagné jusqu’à aujourd’hui, celle des deux acteurs Ryan O’Neal et Ali Mac Graw, la beauté d’Ali McGraw ! brune et naturellement sensuelle se lovant dans la neige, ivre de son bonheur d’aimer…et celle du désespoir de Ryan O’Neal lorsqu’il apprend que celle qu’il aime est atteinte d’une leucémie qui mettra fin au rêve d’une longue vie à deux. La comédie de l’amour, mieux, le marivaudage, puis la sincérité d’un amour déclaré se meut finalement en une tragédie pure…la maladie entre en jeu, la mort s’invite pour rompre leur félicité, et la nôtre du même coup.
Que de larmes versées ! C’est sans doute mon souvenir le plus marquant de ce film, celui de toute une génération ! Nous avons tous beaucoup pleuré en voyant « Love story », notre première histoire d’amour, forcément tragique parce qu’impossible ou rendue impossible par les aléas de la vie, ce qui revient à peu près au même. Le film a bien regardé pleurer toute l’adolescence des années soixante-dix ! Un fleuve d’émotion ruisselant sur nos visages, l’universelle jeunesse des années soixante-dix « aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux », pendant et après, longtemps après la projection.
C’est dans cet état, sans pouvoir échanger le moindre mot que nous sommes sortis de la salle de cinéma, ce jour-là, mon amie et moi. L’image inoubliable, gravée à jamais, de la naissance et de la perte instantanée de nos illusions, évaporées, le temps d’un regard.
C’est là sans doute que s’est construit mon rapport à l’amour, à cet autre insaisissable, quand bien même je l’aurais approché, que la vie de toute façon risquait de me dérober…de m’en éloigner pour toujours.
Je n’ai jamais cherché à revoir « Love story », il y a des films que l’on se satisfait de ne voir qu’une seule fois, c’est ainsi…sans doute parce qu’ils ne laissent pas de vous habiter, fantômes qui ont élu domicile dans votre imaginaire, ils s’y confondent et sillonnent avec vous les méandres de l’existence, « Love Story » en est un.
Aujourd’hui, je réalise qu’à l’époque, il y a le Vietnam, il y a la lutte pour les droits civiques… toujours en marche, la marche du temps, et puis il y a… « Love story » ! Ce hors-temps du contre-courant de l’Histoire… devenu l’emblématique amour de notre génération, ce rêve d’union indéfectible que seule la mort (et encore !) rend vulnérable. Des milliers d’ados en larmes à la sortie des salles, acquis à la cause du mélodrame hollywoodien ! c’est à peine croyable, mais je vous jure que c’est vrai ! (Aujourd’hui, ça marcherait jamais ! Trop kitch ! Quoi que ? )
Un rêve d’amour romantique que seule la fiction peut continuer de nourrir, un remède aux tragédies humaines et politiques du moment, au terrifiant réel.
« Love story ! », le temps d’une séance, m’a donc tenu à l’écart du monde, a détourné mon regard du réel pour le suspendre à celui d’une image, le recentrer sur mes indicibles préoccupations d’enfant.
Ce qui me regardait et me regarde encore d’ailleurs, consistait en une avalanche de questions : Comment aimer ? Qui ? Pourquoi ? Pourquoi vouloir aimer sans souffrir ? Peut-on aimer sans souffrir ? Suis-je aimable ? Qui voudra m’aimer ? Qu’est-ce que c’est qu’aimer ? Un regard de celle qui deviendrait mon Ali Mc Graw.
Voilà mon film, le premier, « Love story », une histoire de vie, un miroir aux reflets chatoyants, un espace intérieur où miroitent une foule d’interrogations, portée par une petite musique, celle de Francis Lai, dont le temps ne parvient pas à effacer les formes virevoltantes.
2001, l’odyssée de l’espace
(Romain Borrelli)
 Lorsque je suis né en 1969, 2001, l’odyssée de l’espace, que nombre de spécialistes s’accordent à considérer comme LE chef d’œuvre de Stanley Kubrick, était sorti sur les écrans un an auparavant, en 1968. Bien évidemment je ne vais pas vous faire croire que j’ai découvert ce film âgé de quelques mois !
Lorsque je suis né en 1969, 2001, l’odyssée de l’espace, que nombre de spécialistes s’accordent à considérer comme LE chef d’œuvre de Stanley Kubrick, était sorti sur les écrans un an auparavant, en 1968. Bien évidemment je ne vais pas vous faire croire que j’ai découvert ce film âgé de quelques mois !
Quelques années plus tard, en 1978 exactement, Georges Lucas nous livre le premier volet de ce qui va s’avérer être par la suite « une trilogie culte » :La guerre des étoiles. J’ai alors 9 ans, et comme nombre d’enfants de l’époque je deviens immédiatement un fan absolu, qui n’attends qu’une chose : la suite !
Je dois à ce stade vous apporter quelques précisions sur le contexte d’alors : à la fin des années soixante-dix nous n’allions pas au cinéma comme aujourd’hui. Le nombre de nouveaux films chaque semaine était bien moins élevé, les complexes multisalles n’existaient pas encore. J’ai le souvenir d’une époque où le fait de se rendre au cinéma était une véritable fête, une sortie qui n’était ni banale, ni anodine. Nous savions plusieurs jours à l’avance que nous irions voir tel film à tel endroit, si bien que nous avions le temps de nous y préparer, de savourer le décompte des jours qui nous séparaient de la projection, jours qui souvent étaient presque aussi délicieux que le moment même du spectacle. Bref, la pression montait peu à peu !
Mes grands-parents habitaient sur les grands boulevards, si bien que lorsqu’il s’agissait de se rendre au cinéma, le Grand Rex était notre refuge. Et somme toute, du cinéma je m’aperçois aujourd’hui qu’à cette époque je n’en connaissais pas grand-chose, exceptée l’œuvre de Walt Disney ! Car il était un rendez-vous familial annuel immuable, la sortie du nouveau Disney, au Rex, précédée par le spectacle de la féerie des eaux. Robin des bois, La Belle et le Clochard, Bernard et Bianca, tel était l’essentiel de ma culture cinématographique…
Fort heureusement arrivait à grand pas l’année 1980, date programmée de la sortie de la suite de La guerre des étoiles, L’Empire contre-attaque. Dark Vador n’avait qu’à bien se tenir !
Un jour, quelques semaine avant le rendez-vous fatidique, imaginez dans quel état de fébrilité je pouvais être, mon père me dit : « le Rex projette en version intégrale l’un des plus grands films de tous les temps. Tu as adoré La guerre des étoiles, tu vas vénérer 2001, l’odyssée de l’espace. » Je n’avais aucune raison de ne pas croire mon père. En général, jusqu’à présent ses choix cinématographiques s’étaient avérés judicieux, et de toute façon toute sortie au cinéma était bonne à prendre. Bien évidemment il n’était pas question pour moi de me documenter sur le film en consultant Internet, puisque le minitel n’avait pas encore fait son apparition. Mais mon père avait une arme fatale qui se nommait « Pariscope », dont la couverture était précisément l’affiche de 2001. Et cela ne fit que me faire saliver d’avance…
Nous voici donc mon père et moi confortablement installés, un esquimau à la main, lorsque retentit la musique du générique, Ainsi parlait Zarathoustra. Jusqu’ici tout allait bien : certes les dix premières minutes du film ne se déroulaient pas dans l’espace, mais cette introduction reposant sur une bande de singes dans le désert visait certainement à nous éclairer sur les origines du personnage de Chewbacca dans La guerre des étoiles, car à ce stade j’étais encore convaincu qu’il existait un lien entre les deux films ! Enchaînement, un grand singe en colère brise le crâne d’un animal à l’aide d’un os gigantesque, puis de rage lance ce dernier en l’air… Le plan suivant est ce qui ressemble à un vaisseau spatial en orbite autour de la terre, chouette le film va enfin commencer ! A nous les navettes interstellaires, les attaques aux lasers fulgurants, les explosions de planètes, les lointaines galaxies… Las ! Rien de tout cela ne se passa ! Pire, je ne comprenais rien. Il n’y avait aucune logique dans l’ordre des scènes ! Qui étaient les gentils et quels étaient les méchants ? Quelles planètes étaient en guerre ? N’y avait-il pas de droïde ?
Mes membres devinrent lourds, ma nuque se raidit, je luttais pour que mes paupières ne recouvrent pas totalement mes yeux… Finalement le sommeil me gagna. La suite reste un souvenir brumeux. Par moment j’ouvrais les yeux pour découvrir sur ma gauche mon père absolument fasciné par le spectacle qui se déroulait sur l’écran. Il reste dans ma mémoire quelques flashs lapidaires : un homme en combinaison orange devant son écran, un autre homme (le même ?) faisant son jogging torse nu en short blanc dans ce qui devait être un vaisseau spatial, encore un autre, en jaune cette fois, flottant dans l’espace au son d’une musique classique. Et surtout une espèce d’œil rouge avec en son centre un autre œil jaune qui me rendormirent définitivement. Un fiasco ! Un calvaire, 2001 ou un interminable chemin de croix.
Quelques mois tard mon père m’emmena voir L’empire contre attaque. Trente plus tard, je n’ai toujours pas revu L’odyssée de l’espace !
Les autres articles de la rubrique
Rappel : 17e Semaine du cinéma
Pépé le Moko de Julien Duvivier
École alsacienne - établissement privé laïc sous contrat d'association avec l'État
109, rue Notre Dame des Champs - 75006 Paris | Tél : +33 (0)1 44 32 04 70 | Fax : +33 (0)1 43 29 02 84