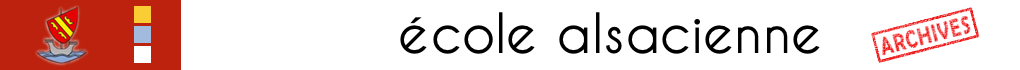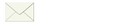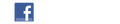Sommaire
Recherche
Connexion
Montenot, Jean / Flaubert, l’huître bourgeoisophobe
De l’homme, on retient en général l’image de la fin, celle du normand solide, aux moustaches tombantes et au crâne dégarni, le regard aux yeux cernés de l’ermite de Croisset, un Viking, mieux, un Sicambre dont la stature « hénaurme » trône au centre de notre littérature. De l’écrivain, on loue le style : images convenues de Flaubert, entré en littérature comme on entre en religion, souffrant mille morts pour terminer une page – « J’ai été cinq jours à faire une page ! » (à Louise Colet, 15 janvier 1853) – et faisant subir à ses textes la fameuse épreuve du « gueuloir », car « une bonne phrase de prose doit être comme un bon vers, inchangeable, aussi rythmée, aussi sonore » (à L. C., 22 juillet 1852). On a pu lui reprocher son style trop soigné, trop recherché et trop travaillé, au point parfois de « sentir l’huile ». Étrange spécimen d’écrivain qui travaille plus pour gagner moins ! Lui, « l’obscur et patient pêcheur de perles qui plonge dans les bas-fonds et qui revient les mains vides et la face bleuie » (à L. C., 7 octobre 1846). Pour faire bonne mesure, on a vanté le style spontané, vivant et direct de sa correspondance. Flaubert s’y livrerait en personne, sans fard. Ces « idées reçues » sur l’écrivain ne sont pas entièrement fausses, bien sûr, mais, trop scolaires, elles risquent de figer l’image que nous avons de lui et de nous faire manquer le reste de cet homme qui « se perd en arabesques infinies » » (à L. C., 13 mars 1854). L’homme et l’écrivain méritent qu’on en approfondisse un peu le portrait, d’autant plus que, comme Flaubert lui-même l’a écrit à propos de Hugo dont il lui est pourtant arrivé de railler la sottise, « plus on le fréquente, plus on l’aime » (à Edma Roger des Genettes, 9 juillet 1874).
Le principe d’impersonnalité
L’homme dans son œuvre d’abord. Chaque écolier connaît la profession de foi du romancier, toute d’impersonnalité : « L’auteur, dans son œuvre, doit être comme Dieu dans l’univers, présent partout, et visible nulle part » (à L. C., 9 décembre 1852). Flaubert, invisible dans son œuvre ? Allons ! Quel biographe ignore qu’il se projette dans les personnages qu’il a créés ? Il est Emma Bovary – on lui a prêté le propos, et on l’a assez répété – jusque dans ses « baisades » : « au moment où j’écrivais le mot attaque de nerfs, j’étais si emporté, je gueulais si fort, et sentais si profondément ce que ma petite femme éprouvait, que j’ai eu peur moi-même d’en avoir une » (à L. C., 23 décembre 1853). Mais Flaubert est aussi bien Charles Bovary. L’arrivée au collège du petit « Charbovary », affublé de sa légendaire casquette, a tous les traits d’un souvenir autobiographique. Homais, le pharmacien, c’est encore Flaubert. Même si, à l’inverse, c’est plutôt le personnage qui déteint sur l’auteur : les inquiétudes de Gustave au moment du procès de Madame Bovary ne sont pas sans rappeler celles de son personnage quand ce dernier craint d’être accusé d’exercice illégal de la médecine. Il est aussi arrivé à « Gustavus Flaubertus Bourgeoisophobus » – c’est ainsi qu’il lui arrive de se désigner dans sa correspondance – de céder au philistinisme bourgeoisoïde qu’il dénonce par ailleurs. Il est, en un autre sens encore, Salammbô, la vierge de Tanit, lunaire et lunatique, ou plutôt, disons que celle-ci est l’incarnation littéraire de son érotisme mystique. Il est aussi bien le prétendant de Salammbô, Mâthô, image magnifiée et « pohëtique » de ses frustrations et de ses emportements de fauve en cage. Dans L’Éducation sentimentale, il est bien sûr Frédéric Moreau, « somme idéale de toutes ses faiblesses » [1]. ; et l’ambitieux Deslauriers, l’alter ego de Frédéric, est une transposition romanesque de Maxime Du Camp, l’ami des années d’études de Flaubert à Paris. Quand à Madame Arnoux, elle est le succédané romanesque de son fameux amour de jeunesse, amour impossible, jamais consommé, pour Élisa Foucault, devenue par la suite Mme Schlesinger, et demeurée son « unique passion véritable » (à L. C., 8 octobre 1846). Félicité, l’héroïne pure et niaise d’Un cœur simple, s’apparente par bien des traits à Julie, entrée au service de la famille comme nourrice, puis comme domestique – Gustave avait cinq ans – et qui y est demeurée jusqu’à la mort de l’écrivain. Flaubert est encore le saint Antoine des diverses versions de la Tentation, fantasmagorie littéraire suscitée par le tableau de Brueghel, dont il a rédigé trois versions, et dans laquelle il s’est « jeté en furieux ». Il est enfin et Bouvard et Pécuchet : « [ils] m’emplissent à un tel point que je suis devenu eux ! Leur bêtise est mienne et j’en crève » (à E. R. des G., 15 avril 1875). Visible dans tant d’autres personnages qui, par maints détails concrets, se rattachent à sa vie, Flaubert a beau dire, malgré ses efforts pour se décentrer, il n’arrive pas à être cet artiste qui « [s’arrange] pour faire croire à la postérité qu’il n’a pas vécu » (à L. C. 27 mars 1852).
Le cogito flaubertien : « l’homme-plume »
À dire le vrai, si la vie de Flaubert est indissociable de sa création, c’est qu’écrire est pour lui comme une seconde vie, double de l’autre qui, trop plate, trop prosaïque à ses yeux, n’en est pas vraiment une : « Un livre n’a jamais été pour moi qu’une manière de vivre dans un milieu quelconque. Voilà ce qui explique mes hésitations, mes angoisses et ma lenteur » (à Mlle Leroyer de Chantepie, 26 décembre 1858). Par la littérature, Flaubert s’échappe de sa condition. « Vivre ne [le] regarde pas », ce qui compte c’est la « refonte plastique et complète [de l’existence] par l’art » (à L. C., 23 janvier 1854). Comme Emma s’enivrant de ses lectures, Flaubert sort de lui-même en écrivant. Cette extase, qui est aussi négation de soi et rejet de la vie, est la seule manière dont il peut vivre : « N’importe, bien ou mal, c’est une délicieuse chose que d’écrire, que de ne plus être soi, mais de circuler dans toute la création dont on parle. Aujourd’hui par exemple, homme et femme tout ensemble, amant et maîtresse à la fois, je me suis promené à cheval dans une forêt, par un après-midi d’automne, sous des feuilles jaunes, et j’étais les chevaux, les feuilles, le vent, les paroles qu’ils se disaient et le soleil rouge qui faisait s’entrefermer leurs paupières noyées d’amour » (à L. C., 23 décembre 1853). Et les jours où il se lâche un peu, l’identité de l’écrivain se dilate loin dans le passé, loin de sa Normandie natale et de la hideur trop humaine de ces êtres ordinaires qu’il ne connaît que trop : « Il me semble, au contraire, que j’ai toujours existé ! et je possède des Souvenirs qui remontent aux Pharaons. Je me vois à différents âges de l’histoire très nettement, exerçant des métiers différents et dans des fortunes multiples. Mon individu actuel est le résultat de mes individualités disparues. – J’ai été batelier sur le Nil, leno à Rome du temps des guerres puniques, puis rhéteur grec dans Suburre, où j’étais dévoré de punaises. – Je suis mort, pendant les Croisades, pour avoir mangé trop de raisins sur la plage de Syrie. J’ai été pirate et moine, saltimbanque et cocher. Peut-être empereur d’Orient, aussi ? » (à George Sand, 29 septembre 1866). Le véritable cogito flaubertien, l’axiome de sa pensée, tient en cette confession : « Je suis un homme-plume. Je sens par elle, à cause d’elle, par rapport à elle et beaucoup plus avec elle » (à L. C., 31 janvier 1852). Un cogito qui consacre l’union charnelle et mystique de l’homme, de l’écrivain et de la langue.
Le credo du romancier
Contradiction, alors ? Non pas ! Le principe d’impersonnalité, formulé à l’époque où il rédigeait Madame Bovary, visait d’abord à tenir en bride la tendance à « se débrailler » du Flaubert première manière. Elle est typique des écrits de jeunesses, textes néoromantiques, sans doute trop immédiatement autobiographiques, mais si instructifs pour connaître l’homme qu’il fut. Certains titres sont par eux-mêmes évocateurs des obsessions et de la mélancolie profonde du jeune Gustave : Bibliomanie, Rage et impuissance, Rêve d’enfer, Passion et vertu, Agonies, Mémoire d’un fou, Novembre. Il lui fallait en outre se préserver des défauts de la première version de la Tentation de Saint-Antoine, texte trop mythologique, trop amphigourique, trop statique. Bref, Flaubert avait à faire taire en lui le romantique généreux qui s’épanche : « Je tâche d’être boutonné et de suivre une ligne droite géométrique. Nul lyrisme, pas de réflexions, personnalité de l’auteur absente » (à L. C., 31 janvier 1852). Ou encore : « plutôt être écorché vif » que de « considérer l’art comme un déversoir à passions » (à L. C., 22 avril 1854). Flaubert, devenu lui-même, ne se départira plus de ce credo d’impersonnalité : « Madame Bovary n’a rien de vrai. C’est une histoire totalement inventée ; je n’y ai rien mis, ni de mes sentiments, ni de mon existence. L’illusion (s’il y en a une) vient au contraire de l’impersonnalité de l’œuvre. C’est un de mes principes, qu’il ne faut pas s’écrire » (à Mlle L. de C., 18 mars 1857). Et pourtant, Emma Bovary n’en est pas moins emplie de lui. Lui ? Mais, qui donc ? Une énigme, pour nous, et, s’il faut l’en croire, peut-être d’abord pour lui-même : « Je voyage en moi comme dans un pays inconnu, quoique je l’aie parcouru cent fois » (à L. C., 11 août 1846). Sartre a tenté ce voyage, et même s’il met beaucoup de sa philosophie (et de lui-même) dans sa somme sur Flaubert, il a su, dans L’idiot de la famille, en mesurer la complexité et en montrer la richesse. Même si, contrairement à sa provocante formule, on n’entre pas « dans un mort comme dans un moulin », il faut rappeler comment Flaubert est devenu Flaubert.
La vocation précoce de « l’idiot de la famille »
Second fils du médecin-chef de l’hôtel-Dieu de Rouen, Flaubert est né et a grandi au sein d’un hôpital, dans un milieu de carabins. Cela compte. Premières images et premier contact avec l’idée obsédante de la mort : « L’amphithéâtre de l’Hôtel-Dieu donnait sur notre jardin. Que de fois, avec ma soeur, n’avons-nous pas grimpé au treillage et, suspendus entre la vigne, regardé curieusement les cadavres étalés ! Le soleil donnait dessus ; les mêmes mouches qui voltigeaient sur nous et sur les fleurs allaient s’abattre là, revenaient, bourdonnaient ! (...) Je vois encore mon père levant la tête de dessus sa dissection et nous disant de nous en aller » (à L. C., 7-8 juillet 1853). Mais – et cela n’est en rien contradictoire – il fut aussi un enfant joueur, espiègle, farceur. En témoigne le « Garçon », création collective avec ses amis d’enfance et sa sœur Caroline, personnage imaginaire destinée à choquer le bourgeois, préfiguration de l’Ubu de Jarry et qui reparaît de loin en loin, par « morceaux » [2], dans des personnages, comme Homais ou Charles Bovary. Gustave enfant faisait parfois le gugusse, le comédien bouffon, il était aussi l’auteur des saynètes jouées avec Caro et ses amis dans la salle de billard de l’Hôtel-Dieu. On ne saurait donc lui accorder qu’il eut une « amère jeunesse » (juillet 1845) et l’on est plutôt enclin à s’en remettre au narrateur des Mémoires d’un fou : « J’étais gai et riant, aimant la vie et ma mère ». Plus difficile à apprécier, un témoignage tardif de sa nièce, qui s’appelait aussi Caroline, nous apprend que Flaubert, à la différence de son frère et de sa sœur, plus doués, aurait eu quelques difficultés à apprendre à lire. Flaubert, enfant attardé ? Sartre (et beaucoup d’autres) y ont cru. En tout cas, si l’entrée dans l’univers des mots a pu être difficile, le petit Gustave a vite rattrapé ce retard supposé. Il propose, alors qu’il n’a pas dix ans, dans une lettre à son ami Ernest Chevalier : « de nous associers [sic] pour écrire moi, j’écrirait [sic] des comédies et tu écriras tes rêves » (1er janvier 1831). Gustave s’est donc très tôt imaginé dans la peau d’un écrivain.
La « folie de Flaubert » entre crise et deuils
Au collège, il n’a pas rencontré que l’ennui, certains de ses professeurs ont même su discerner et stimuler sa vocation. Ni « l’apparition » d’Élisa – Madame Schlésinger –, ni la découverte sans enthousiasme du commerce charnel (paraît-il auprès de la femme de chambre de sa mère) n’ont détourné l’adolescent rêveur devenu un jeune homme fantasque d’une marche molle vers l’honnête bourgeoisie à laquelle des études de droit auraient dû le conduire. C’est un incident opportun, en un sens, qui a mis un terme à cette évolution, laquelle eut peut-être amené Gustave à renoncer à sa vocation littéraire. La plupart des médecins s’accordent pour qualifier de crise épileptique l’accident qui survint en janvier 1844. L’effet est immédiat : repos et arrêt des études. Le père Flaubert est assez riche pour assurer à ce fils fragile une vie de rentier, cela d’autant mieux que l’aîné – qui est médecin et se prénomme Achille comme son père – est sur les rails pour prendre la suite. Mais cette suite est plutôt sombre pour la famille. Coup sur coup, Achille-Cléophas, le père, et Caroline, la sœur chérie, meurent au début de l’année 1846. À partir de cette date, sauf quelques voyages et des escapades à Paris, Gustave vit à Croisset, dans la maison familiale, entre sa mère et sa nièce : « Destiné à me mariner sur place, j’ai fait orner mon bocal à ma guise et j’y vis comme une huître rêveuse » (à Ernest Chevalier, 12 août 1846). Sédentaire, il soigne son image de solitaire renfrogné : « Je m’enfonce chaque jour dans une ourserie qui prouve plus en faveur de ma moralité que de mon intelligence » (à Maurice Schlésinger, 24 novembre 1853).
Un livre sur rien
Ladite huître n’aurait jamais donné de perles, si, entre la rédaction de la première version de La tentation de Saint-Antoine et celle de Madame Bovary, ne s’était opérée en lui une révolution de ses conceptions esthétiques, période cruciale, où Flaubert devient Flaubert. Entre septembre 1849 et septembre 1851, il n’écrit pas, hormis quelques observations du voyage en Orient, entrepris avec Du Camp, voyage durant lequel il fait moisson d’images, se donne des « ventrées » d’orientalisme, mais au fond s’ennuie. C’est qu’il est travaillé par l’échec de la première Tentation : ses deux amis, Maxime Duc Camp et Louis Bouilhet, à qui il a lu, avant son départ, son texte trente-deux heures durant, lui ont conseillé d’en brûler le manuscrit et d’en abandonner le projet. Verdict sévère qui a contraint Flaubert à remettre en cause sa manière d’écrire. Plus tard, il a diagnostiqué ce qui n’allait pas dans la Tentation : le défaut de plan et la construction insuffisamment élaborée : « Les perles ne font pas le collier : c’est le fil. J’ai été moi-même dans saint Antoine le saint Antoine » (à L. C., 1er février1852). Vraisemblablement à l’instigation de ses amis, il change de sujet : une histoire d’adultère située dans une petite ville imaginaire de Normandie, l’histoire d’une femme qui a la passion d’être une autre. Ce sera Madame Bovary. Yonville vaut bien Constantinople ! D’ailleurs, l’histoire a-t-elle tant d’importance ? « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style (...) » (à L. C. 16 janvier 1852). Un livre sur rien ? En tout cas, le chef d’œuvre qui rendit Flaubert célèbre est peuplé d’êtres médiocres, d’âme basses dont il scrute, non sans quelque délectation, les moisissures.
Bovarysme de Flaubert ?
Certains jouissent pleinement de leur médiocrité, comme Bovary ou Homais – à peine la perçoivent-ils —, ou encore comme cet Abbé Bournisien qui manquerait de temps pour les besoins spirituels de ses paroissiens s’il était seulement capable de les reconnaître. D’autres, dont l’existence n’est qu’une lente défaite, en souffrent plus ou moins confusément. Ils finissent par renoncer, impuissants, ballottés et déchirés entre le désir de devenir ce qu’ils rêvent d’être et l’ennui de devoir demeurer ce qu’ils sont. Nombre des héros flaubertiens de la maturité sont atteints de ce mal que Jules de Gaultier a baptisé, en 1892, du terme de « bovarysme » et qu’il définit comme le « pouvoir départi à l’homme de se croire autre qu’il n’est ». Emma devient ainsi l’emblème du type mélancolique et acédique des personnages flaubertiens. Plus ou moins ratés, plus ou moins ridicules, plus ou moins sublimes dans leur pathétique même, reflets de Flaubert et, plus souvent encore, miroirs à peine déformant que l’écrivain tend à ses lecteurs, ces personnages faibles inspirent en même temps compassion et dégoût. Flaubert lui-même a-t-il été atteint de bovarysme ? Oui, et non, car il se soigne en écrivant pour lui-même et contre le monde, tandis qu’Emma, elle, n’écrit pas et que Frédéric Moreau n’a que des velléités d’écriture.
La tentation théâtrale de saint Gustave
Mais quand Flaubert écrit pour le siècle, pour séduire son temps qu’il abhorre, c’est un fiasco. On a oublié qu’il s’est essayé au théâtre, qu’il a tenté de descendre de son Aventin de Croisset pour aller à la recherche du succès et jouir un peu de sa célébrité. Il est vrai que l’écrivain avait alors besoin d’argent, pas pour lui, mais pour sa nièce. Sa pièce, Le Candidat (1873), satire des mœurs politiques, fut un échec : « Pour un four, c’en est un. […] J’avoue qu’il m’aurait été agréable de gagner quelque argent, mais comme cette chute-là n’est ni une affaire d’art, ni une affaire de sentiment, je m’en bats l’œil profondément » (à G. S., 12 mars 1874). Ni gloire facile, ni argent frais ne récompensent cette ultime tentation de « saint Gustave ». Décidément, il n’est pas fait pour les succès faciles. La réplique de Flaubert à son époque, son ultime cadeau, sera un florilège des bêtises de l’humanité à travers le projet inachevé d’un Dictionnaires des Idées reçues et les aventures un peu croquignolesques de Bouvard et de Pécuchet. « Tout cela dans l’unique but de cracher sur mes contemporains le dégoût qu’ils m’inspirent ».
L’encyclopédiste de la Bêtise
Sans nul doute l’une des clés de la lecture de l’œuvre de Flaubert : le combat contre la bêtise sous toutes ses formes, véritable leitmotiv de son rapport au monde : « Je sens contre la bêtise de mon époque des flots de haine qui m’étouffent. Il me monte de la merde à la bouche, comme dans les hernies étranglées. Mais je veux la garder, la figer, la durcir. j’en veux faire une pâte dont je barbouillerais le XIXe siècle, comme on dore de bougée de vache les pagodes indiennes. » (à Louis Bouilhet, 30 septembre 1855). Guerre ouverte à la bêtise qui lui « donne la rage », qui fait de lui « un Marat insociable ! » (à Léonie Brainne, 14 juin 1872). Sa guerre ne prend pas seulement la forme commode et rassurante de l’imprécation : Flaubert ne se contente pas d’être le vates de la bêtise d’autrui. Il ne moralise pas. Il montre le mal croître en lui. La Bêtise est enfin saisie pour ce qu’elle est : une dimension même de l’existence humaine, sa force d’inertie est presque métaphysique. Flaubert, tel saint Antoine « ahuri, un peu niais […] voyant défiler devant lui les différentes formes de la tentation », en a fait l’expérience en lui-même et pour lui-même. Ni les progrès de la science, ni ceux de la technique moderne – rappelons Flaubert était atteint de sidérodromophobie – qui, au total, tendent à affermir cette Bêtise, ni l’art, ni même la littérature, fut-ce la sienne, qui pourraient prétendre en alléger le poids, n’en viendront à bout. De cette vérité, même ses détracteurs lui en sont redevables.
Lire, novembre 2007
[1] Albert Thibaudet, Gustave Flaubert, TEL, p. 135
[2] Albert Thibaudet, Gustave Flaubert, TEL, p. 22.
Les autres articles de la rubrique
Marbeau, Michel / L’Affaire Weidmann,
Colodiet, François / La République et (...)
Catonné, Jean-Marie / Des idées et (...)
Montenot, Jean / Descartes était-il (...)
Ourednik, Patrik / Ma fille a cinq (...)
Colodiet, François / Carnets de (...)
Montenot, Jean / En attendant (...)
Ourednik, Patrik / Les temps sont (...)
École alsacienne - établissement privé laïc sous contrat d'association avec l'État
109, rue Notre Dame des Champs - 75006 Paris | Tél : +33 (0)1 44 32 04 70 | Fax : +33 (0)1 43 29 02 84