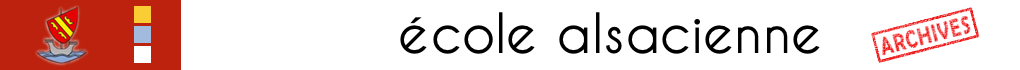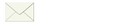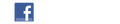Sommaire
Recherche
Connexion
In Memoriam, Jean-Louis Steinberg (AE)
Quand la mémoire fait l’histoire
C’était un peu comme un pèlerin de Saint Jacques. On avait l’impression qu’il avait fait un long parcours. Une sacoche à la main, une bouteille d’eau, attachée au sac avec un petit peu de corde. Fatigué sans doute. Le parcours, le poids des ans. Mais un regard d’acier, une flamme, une détermination sans faille. Il faut encore marcher. Quel objectif ? Tel le pèlerin, aller au bout d’un parcours. Après une belle vie consacrée à la physique, à l’amour, à la paternité et à la fraternité, il reste un devoir : transmettre. Dire ce que l’on porte en soi depuis si longtemps, l’événement originel, celui qui a tout transformé. Comme une auto-analyse, revenir à ce qui compte : les siens. Mais surtout celle qui l’a porté, élevé, sa mère. On en revient toujours à la mère. Les blessés dans le no man’s land pendant la Première Guerre imploraient leur mère. Là, c’est plutôt un vide. Une phrase résonne fortement pendant son récit : « elle me manque encore souvent aujourd’hui ». Une quête donc. Un tombeau, un hommage à ceux qui ne sont plus là, mais encore bien là. On pourrait intituler ce témoignage Au nom de tous les miens, mais le titre a déjà été choisi, il y a quelques décennies par Martin Gray. Mais témoigner, c’est aussi un devoir, un acte politique. Dire ce que l’on a vu, ce que l’on a dans sa chair, pourquoi ce numéro A 16 878 sur l’avant-bras gauche que l’on exhibe parfois pour montrer un acte de plus de déshumanisation, n’être qu’un numéro… Or il est un des derniers. Combien peuvent encore témoigner ? Après une belle vie, choisie, construite, qui lui a apporté joie et sentiment d’accomplissement, il reste donc ce devoir de mémoire, cette expérience unique que seuls quelques-uns peuvent encore porter. Après ce sera fini, la grande faucheuse emportera les témoins de ce qui s’est passé dans ce lieu au nom étrange, pas forcément facile à prononcer, loin, à cinq jours de wagon à bestiau fermé du convoi n°76 parti de Drancy le 30 juin 1944 : Auschwitz. C’est là que sont morts un million de personnes. Des juifs avant tout, des Tziganes aussi. Mais surtout les siens. Car ce qu’il a vécu en direct, ce n’est pas encore la grande histoire, mais la petite, la sienne. Mais plus tard les deux histoires se confondent. Au soir de sa vie, cette expérience limite devient aussi une nécessité politique. Celle d’ouvrir les yeux d’une jeunesse certainement insouciante. La bête est toujours là, elle rôde. Les victimes ne sont plus les juifs mais les musulmans bosniaques, les Tutsis du Rwanda… L’horreur continue. Certes l’histoire ne se répète jamais vraiment, mais l’homme est toujours capable de produire les crimes collectifs les plus terribles. Témoigner pour agir aujourd’hui et demain. Les jeunes doivent comprendre qu’ils sont confrontés aux processus permanents d’exclusion, de racisme et d’antisémitisme qui peuvent mener au pire. Modestement, ce témoignage est un apprentissage à la prise de conscience, à la résistance.
On ne sort jamais indemne du récit de Jean-Louis Steinberg. Même si l’auditeur sait par avance que le récit sera dramatique, il est transporté, balloté dans cette histoire de la Deuxième guerre mondiale. Ce n’est pas une œuvre littéraire, il n’y a pas d’effet de manche. La diction, le ton de Jean-Louis Steinberg, très spécifique, rend le récit d’autant plus dramatique. Il raconte juste sans concession, avec ses mots à lui ce qu’il voit, mais aussi, ce qui est parfois plus difficile à imaginer, ce qu’il sent, ce qu’il entend. Auschwitz, c’est une agression presque permanente de tous les sens. Forcément, la litanie du récit de ce qu’il voit nous écœure… mais encore, c’est soixante ans après, dans une salle de classe agréable d’un lycée parisien. Comment imaginer en direct ? Pourquoi continuer à vivre tout ça ? Ne faut-il pas s’arrêter, précipiter son sort afin de ne plus subir ? Accepter d’être emmené dans une soi disant douche et finir en fumée dans un nuageux ciel d’automne polonais.
Non. Jean-Louis Steinberg n’est pas homme à accepter un sort pourtant prévisible. Même si sur ce quai de la « gare » d’Auschwitz, on lui a ordonné d’aller vers la gauche, c’est-à-dire la vie et non vers la droite, c’est-à-dire l’anéantissement immédiat. Cette vie accordée, n’est à priori qu’un sursis, ne peut normalement pas durer. Quoi ? trois mois, quatre en moyenne ? Il va subir le travail forcé, le manque de nourriture, la violence. Des scènes qu’un jeune homme de son âge n’aurait jamais dû voir. Il sait que sa mère a été exécutée rapidement. Il sait que son père jugé inapte au travail n’ira jamais dans une maison de repos, comme des SS lui ont promis. Et pourtant il tient. En effet, Jean-Louis Steinberg bénéficie sans doute d’une résistance peu commune, mais il est aussi animé par une foi. Non pas religieuse, il est totalement athée. Il est tout à fait « celui qui n’y croyait pas » de La Rose et le Réséda. Il est animé par une conscience politique. C’est aussi un homme engagé. Il va retrouver cette lumière dans un tel chaos. Il intègre la résistance clandestine communiste du camp. Il n’est plus seul. Il comprend que le premier acte de résistance est de tout faire pour demeurer un homme à part entière : rester propre physiquement et moralement. Cette volonté et cette solidarité entre quelques hommes est essentielle. Mais face à l’arbitraire, il faut aussi tenir compte d’un facteur majeur : la chance. Après l’évacuation d’Auschwitz en janvier 1945, il participe aux exténuantes « Marches de la mort ». Sur un groupe de 135, 30 seulement parviendront à Dora Buchenwald. Jean-Louis en fait partie, son frère Claude succombe peu après.
Le temps de la Libération arrive heureusement. Il n’a que 23 ans, il pèse 35 kilos et tout le monde se lève pour lui laisser une place dans le métro parisien. Il n’a que 23 ans, mais il a déjà vécu toute une vie. Il a vécu plus que nous tous réunis ne vivront heureusement jamais.
Si Jean-Louis a pu aussi témoigner dans de nombreux autres établissements, sa présence et son récit avaient une résonnance particulière à l’Ecole alsacienne, où il avait été quelques années élève. De plus, il était à peine plus âgé que ces élèves quand cette histoire dramatique l’a submergé. Une forme d’identification pouvait être possible. À la fin de son récit, il demandait si les élèves avaient des questions à lui poser. Ces derniers avaient souvent du mal à en formuler, comme si le témoignage les avait assommés. Une fois Jean-Louis Steinberg parti, un long silence se manifestait à chaque fois. Plus tard, une discussion pouvait s’engager.
Je lui ai un jour demandé s’il ne voulait pas publier son récit. Je lui ai dit que je pourrais peut-être l’aider. Il a poliment décliné cette proposition : il avait déjà commencé à travailler dans ce sens avec un autre professeur. Quelques mois plus tard, il m’a rappelé en m’annonçant avec tristesse que le professeur en question était prématurément décédé. J’ai donc repris le flambeau avec lui. Nous avons travaillé sur le manuscrit et j’ai demandé à l’un de mes vieux amis qui dirigeait l’Association des Anciens Élèves de l’École Alsacienne (AAEEA), Yann Legargeant, si une publication était envisageable. Il fut tout à fait disposé à se lancer dans l’aventure. Comme nous allions ensemble monter un grand salon du livre de l’Ecole alsacienne, nous avons jugé bon de faire paraître le récit de Jean-Louis Steinberg à ce moment précis, le 8 décembre 2004. C’est ainsi que Des quatre, un seul est rentré, a commencé à être diffusé.
Pour finir, osons poser cette question : le récit de Jean-Louis Steinberg a-t-il une valeur historique ? Malgré quelques transformations, on peut globalement considérer que son récit est un témoignage de première main. Ni mon collègue, ni moi n’avons voulu transformer ou nous approprier le récit de Jean-Louis, d’autant que sa valeur historique nous paraissait d’emblée évidente. Si on compte des dizaines de milliers de témoignages sur la Shoah, celui-ci reste unique pour tous ceux qui l’ont entendu, notamment par la perspective personnelle des faits, qui donne du corps et de la chair au récit et qui apporte un aperçu individuel inédit au processus génocidaire. On a voulu nier l’individu, le faire rentrer dans un processus de déshumanisation collective. Or le récit de Steinberg, comme celui de tous les rescapés, témoigne de cet échec.
N’en déplaise aux négationnistes, ce récit est fondé sur une expérience limite vécue, qui appartient à l’histoire du XXe siècle et par sa violence et son ampleur à l’histoire de l’humanité. Un esprit chagrin pourrait peut-être retrouver ça et là quelques approximations ou erreurs, mais comment peut-il en être autrement lorsque l’on vit dans ces conditions, lorsque l’on est privé de tout ? Certes il y a des données non vérifiables… mais pourquoi douter, et notre connaissance du phénomène et de nombreux autres témoignages, rend l’ensemble tout à fait crédible. C’est en regroupant tous ces récits et en procédant à leur analyse, à des vérifications, en les recoupant que l’on peut vérifier certains détails historiques, apporter de nouvelles informations. De plus, certains renseignements ne peuvent être obtenus que par ce type de témoignage. Les archives ne contiennent pas tout. Les sources dont dispose l’historien du génocide sont donc variées et le témoignage est un élément essentiel. Sa valeur est même reconnue dans le cadre de procès contre des nazis ayant pu participer au processus génocidaire puisque, depuis Nuremberg, des témoins sont pris en compte.
Michel Marbeau.
Historien, professeur à l’École alsacienne.
École alsacienne - établissement privé laïc sous contrat d'association avec l'État
109, rue Notre Dame des Champs - 75006 Paris | Tél : +33 (0)1 44 32 04 70 | Fax : +33 (0)1 43 29 02 84