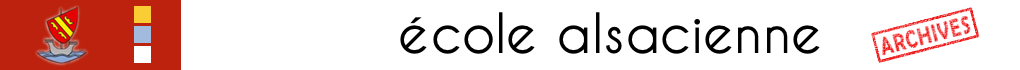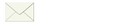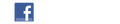Sommaire
Recherche
Connexion
Histoire d’un miracle (1965)
Cahiers de l’EA, 10, 1965
Souvenirs de Nathalie Stepanoff-Kantchalovsky, professeur de russe.
La rédaction de « Sang Neuf » me demande d’écrire quelques mots sur la langue russe. C’est difficile pour moi. Il est difficile et presque gênant de parler de ce qui vous touche directement, de ce qui fait partie de vous-même. Il me serait plus facile de parler du français, des Français, de la France - du rôle que cette langue, ce peuple, ce pays ont joué et jouent dans ma vie. Si j’avais l’idée d’écrire mes souvenirs (mais je ne pense nullement qu’ils en vaillent la peine), je les intitulerais « La vie est un miracle ». Car je la vois ainsi. Lorsque, parfois, je regarde en arrière, je vois un chemin qui serpente, qui serpente et, à chaque tournant ; c’est un nouveau décor et, partout, des miracles.
Il y en a un qui concerne l’École alsacienne, la langue française et la langue russe. C’est ce miracle que je voudrais raconter ici. Mais pour le faire il faut revenir en arrière, bien loin, bien loin, à plus d’un demi siècle.

Octobre 1912. Je débarque à Paris, sortant d’une forêt russe, avec papa, maman, mon frère et mes deux soeurs. Le lendemain mon père nous met à l’école. J’y vais avec Jean, mon frère, en classe de 8e. C’est l’École alsacienne. Comme je me le rappelle, ce premier jour ! La classe etait commencée quand nous arrivâmes. Un professeur, pas grand, aux joues roses et aux cheveux en brosse, nous accueillit très gentiment. C’était M. Fischer, professeur de français. A la récréation, je m’assis sur les marches de l’escalier, dans un coin de la cour. Un groupe de garçons m’aborda et me dit à brûle-pourpoint :
« Quelle est ta patrie ?
— La Russie.
— Vive la Russie, vivent les Alliés ! »
Ce fut mon premier contact avec mes camarades. Amitié était faite. Je le sentis, mais, à vrai dire, je n’y compris rien. Les Alliés ? Pourquoi ? Qu’est-ce que c’était ? Le soir, chez nous, 9 rue du Val-de-Grâce, mon père nous expliqua l’Entente cordiale.

Je m’habituai vite à notre nouvelle vie. Le Val-de-Grâce, le Luxembourg, l’École alsacienne devinrent rapidement une seconde patrie pour moi. A l’école c’était l’époque de M. Beck, de M. Breunig, de M. Bouer. Mes professeurs étaient M. Fischer (français), M. Muller (calcul), et, pour le dessin, un grand jeune homme très droit, avec sous le nez, une petite moustache noire. Il ne marchait pas, mais volait dans la classe. Il m’encourageait et je l’aimais beaucoup. C’était M. Testard. Je fis à l’école ma 8e et ma 7e. Mon carnet de correspondance atteste mes progrès, plus satisfaisants que ma conduite. Passons... À cette période de ma vie, le français fut ma langue principale. Comme mon frère et mes soeurs, je ne voulais plus parler russe. C’est alors que mes parents décidèrent de passer les vacances en Russie.
Juin 1914. Changement de décor. Après un voyage de deux jours en taxi, en train, en troïka, je me retrouve dans notre « datcha », à la lisière d’une forêt de plusieurs milliers d’hectares, au bord de la Moskowa, à une quinzaine de kilomètres du champ de bataille. Bon gré, mal gré, il fallut bien parler russe. Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines se moquaient de nos fautes et nous appelaient « les Français ». Qu’importe ! Quelle joie c’était de retrouver ma première patrie, ses fraises des bois, ses cèpes, et Vaska, le cheval gris, que, toute petite encore, j’avais déjà monté. Cela dura deux mois et... la guerre éclata. J’entends encore les grelots de la troïka qui emportait mon père vers l’Armée.
Au lieu du retour à Paris, ce fut le retour à Moscou. Au lieu de l’École alsacienne, la « gimnasia » (le lycée) russe. C’était un lycée de filles. Après les garçons français, mes nouvelles camarades, me parurent plutôt fades. Une vraie nostalgie allait s’emparer de moi. Mais la neige, les patins, la luge en eurent bientôt raison. Autre consolation : au lycée, mon français devint très vite célèbre. La Française, Mme Pommayre, m’adorait. Aux compositions, la classe ne comptait que sur moi. Et je me délectais de cette gloire toute gratuite.
1917. C’est la révolution. Puis c’est la guerre civile. Les combats dans les rues. Les morts sous nos fenêtres. Pas de pain. Pas de chauffage. Les écoles sont fermées. C’est la paix séparée. Quelle honte ! Nous, les Alliés ! Que pensent nos camarades de l’École alsacienne ? Mon frère et moi, nous ne les oublions pas, nous parlons souvent d’eux. Le décor change encore. Mes parents quittent Moscou et nous nous installons dans notre « datcha » en pleine forêt. À défaut de pain, il y a au moins du bois. Mais il faut le couper, le scier, le fendre, monter l’eau à bras, défricher le terrain pour faire un potager, traire la vache, apprendre, en un mot, le rude métier du paysan russe. Et les études ? Que deviennent-elles ? Mon père est implacable. Elles doivent continuer. Avec, en guise de lampe, une veilleuse à mèche, la version latine sera faite, les textes allemands appris, les dissertations écrites. Le professeur de mathématiques est à 10 km. Pour cela, il y a les skis. Seule une tempête de neige peut nous dispenser de la course.
Pas un instant de répit ! Printemps, été, automne, hiver – le travail variait, mais n’arrêtait jamais.
Le seul domaine où j’étais libre, où je n’avais pas de comptes à rendre était le français. Je l’étudiais à ma façon, aux heures de pâturage, lorsque c’était mon tour d’y aller. Plus de grammaire, de participes passés, de correspondance de temps. Je ne faisais que lire, et je ne m’en privais pas : Molière, Rousseau, Hugo, George Sand, Musset, Vigny, Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, bien d’autres encore m’accompagnaient pour des journées entières dans la forêt ou dans les champs. Personne ne me les expliquait et, donc, ne me les gâtait. Ils me parIaient eux-mêmes, je les découvrais moi-même. A travers eux, la France de mon enfance grandissait, dépassait son cadre, prenait un sens nouveau et je rêvais : « La reverrai-je un jour ? »
Cette vie dura quatre ans. La guerre civi le prit fin. La vie redevenait normale. Les magasins s’ouvraient, les écoles aussi. Nous revînmes à Moscou.
Ce fut alors que mon français joua un rôle décisif, non seulement dans ma vie, mais dans celle de ma famille. N’étant pas marxiste, mon père n’avait plus de place dans l’Université. Il me fallait gagner ma vie et aider mes parents. Je me mis à enseigner. A enseigner le français, cela va sans dire. Que pouvais-je enseigner d’autre ? J’organisai des groupes et j’eus beaucoup d’élèves de tous âges et de toute condition – des bébés de quatre ans et des savants de soixante. À peine sortie de l’Université, j’y rentrai comme professeur. C’est à la langue française que ie dois le métier que j’ai exercé à Moscou.
Tout allait bien pour moi. J’enseignais le français aux étudiants russes. Je m’occupais donc toujours de ma seconde patrie. Mais... il y avait un mais. Je voulais revoir la France et ne le pouvais pas. J’étais dans une cage. La cage était grande, c’est vrai, mais une cage reste une cage malgré tout. La mienne était bien bouclée. Impossible d’en sortir. La vie dans une cage n’est pas une vie complète. Les années passaient... Je voulais être libre, je voulais aller en France et je ne le pouvais pas.
Été 1941. Encore la guerre. Comme en 1914, je suis dans notre vieiIle datcha, dans la forêt. Les combats sévissent à quelques kilomètres de là. La cage vole en éclats... du côté de la France. Au risque d’y laisser sa vie, on peut sortir. Eh bien, qui ne risque rien n’a rien. Un jour d’hiver, dans le froid, la neige, la guerre, je m’en allai. J’avais un but : la France, Paris.
Le voyage à travers l’Europe d’abord en feu, puis en ruines, dura six ans...
Octobre 1947. Me voilà enfin à Paris. Le décor de mon enfance est intact. Devant moi, le Val-de-Grâce, le Luxembourg. Par les mêmes rues, lentement, je vais vers l’École alsacienne. J’y vais seule. Mon frère Jean a été tué à la guerre. J’entre. Ce sont les mêmes cours, les mêmes classes, les mêmes escaliers où j’ai tant couru. Deux de mes professeurs sont encore là. M. Fischer n’a plus les joues roses. Quant à M. Testard, au lieu d’une moustache noire, il a une moustache blanche. Pour le reste, il est bien le même.
Je suis à Paris ! Ce n’est pas un rêve, c’est la réalité.
Quelques années encore passent. Et voilà qu’un jour, je me trouve par hasard rue NotreDame-des-Champs. Un doigt touche ma tête et une voix mystérieuse me dit à l’oreille : « Va à l’École alsacienne, et demande si l’on n’y aurait pas besoin d’un professeur de russe ». J’obéis à la voix. J’entre. À cette minute M. Fischer sort du pavillon avec sa classe. Je lui expose mon désir. Au même moment paraît M. Hacquard, le directeur. M. Fischer me présente et explique mon cas. M. Hacquard m’emmène dans son cabinet.
Une semaine après, je donnais ma première lecon de russe à l’école.
J’y enseigne depuis dix ans. Le miracle est accompli et je remercie Dieu : Mon port de départ est devenu mon port de refuge, et mon exil est un retour.
Nathalie Stepanoff-Kantchalovsky
Sang neuf, 10, 1965
École alsacienne - établissement privé laïc sous contrat d'association avec l'État
109, rue Notre Dame des Champs - 75006 Paris | Tél : +33 (0)1 44 32 04 70 | Fax : +33 (0)1 43 29 02 84