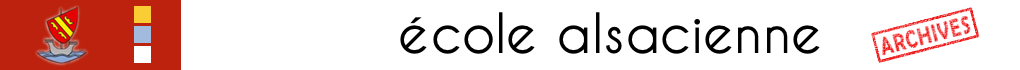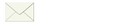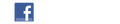Sommaire
Recherche
Connexion
Apprendre, c’est désirer savoir.
Par Laurence Letourneux, professeur de lettres
Pour remercier l’École de me permettre, depuis trois ans, une passionnante reprise d’études en psychologie à l’Université Paris-Diderot (Paris 7), je voudrais rendre compte brièvement de ce que j’ai pu expérimenter pendant mon stage de Master, l’an dernier, à l’UPPEA (Unité de Psycho-Pathologie de l’Enfant et de l’Adolescent) à l’hôpital Sainte-Anne, dans un service dirigé par le Dr Évelyne Lenoble, considéré depuis quelques années comme Centre référent pour ce qu’on appelle les « troubles de l’apprentissage ». Le travail des psychologues (passation de tests et de bilans, généralement demandés par l’institution scolaire) se déroule dans un cadre d’orientation psychanalytique : ce qu’on y écoute en priorité, c’est le désir de l’enfant, la façon dont il investit, de ses pulsions, de ses fantasmes, de toute la complexité de son histoire familiale, le savoir ou plutôt le rapport qu’il entretient avec le savoir.
La première leçon que j’ai pu tirer de ce stage - je travaillais avec une des psychologues du service autour des troubles de la lecture : soit que les enfants déchiffrent très laborieusement les mots en fin d’école primaire, soit qu’ils n’accèdent pas aux correspondances grapho-phonétiques, c’est que l’analyse de Freud selon laquelle il y aurait une pulsion de savoir à la source des apprentissages se révèle souvent très pertinente lorsqu’on écoute les patients. Pour le fondateur de la psychanalyse en effet, tout enfant est d’abord un petit Oedipe qui cherche, qui enquête, et qui mobilise toute son énergie pour découvrir le sens de ce qui se passe autour de lui, les secrets des grandes personnes, le dessous des choses... surtout celles qu’on lui cache ! C’est ce qu’on appelle « la scène primitive » qui orienterait inconsciemment sa recherche, la question éternelle : d’où je viens ?
La question de l’apprentissage nous oblige alors à remonter aux origines de cette curiosité et à sa dimension fantasmatique : ouvrir un dictionnaire n’est-ce pas toujours y chercher les mots interdits ? Il y a dans le rapport au savoir cette part infantile pulsionnelle qui peut résister à la logique cognitive et qui suscite souvent l’incompréhension des professionnels de l’éducation et des parents. Je pense notamment aux propos de la mère d’une jeune fille (Ysaure) qu’on a reçue dans le bureau de la psychologue à l’UPPEA : « on arrive en 6è et y a toujours le même blocage », « au niveau français, tout ce qui est dictée, elle fait des fautes à toutes les phrases, les mots invariables le surlendemain y a plus rien, l’institutrice ne la note même plus ». Plus tard, Ysaure évoque elle-même les devoirs qu’elle fait avec sa maman : « c’est bien, dès que j’ai des mots faux, elle refait une dictée pour voir si c’est rentré ».
Dans ces paroles exemplaires de ce qu’on peut entendre au cours des entretiens, il y a d’abord ce terme de « blocage » employé par presque tous les parents et les enfants : il dit à la fois quelque chose de la façon dont on conçoit a priori l’apprentissage comme un processus chronologique, cumulatif, et quelque chose de la force opaque de résistance qui s’y oppose.
Or l’apprentissage, ou plutôt le rapport au savoir – comme rapport de désir, ne fonctionne pas sur ce modèle linéaire : il a son temps propre, qui relève de la façon dont chaque enfant cherche sa place singulière dans la famille, à l’école, à travers les histoires qu’on lui raconte, et même dans les calculs qu’il doit faire... Les matières scolaires font sens différemment pour chacun et peuvent susciter un blocage, dont les vrais noms seraient, entre autres, l’inhibition, la phobie, l’angoisse, c’est-à-dire tous ces mécanismes qui viennent barrer ou interdire la pulsion épistémophilique : tout ce que l’enfant ne peut pas ou ne veut pas savoir.
Mais, deuxième constat, on préfère souvent recouvrir cette réalité psychique par d’autres constatations plus techniques, apparemment plus scientifiques : Ysaure par exemple est diagnostiquée comme dyslexique et dysorthographique. Ces termes en dys- abondent pour spécifier les troubles de l’apprentissage car ils ont pour les parents et les professionnels de l’éducation une fonction utilitaire : assurer une prise en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), un tiers-temps pour les examens scolaires, etc. Ces termes signifient un défaut, un dysfonctionnement dans un processus mental conçu comme une inscription progressive de connaissances dans la mémoire : c’est le paradoxe des « mots invariables » que la petite fille ne retient pas ; il faut refaire une dictée « pour voir si c’est rentré ».
Or la question qu’on se pose à Sainte-Anne est celle de l’interprétation de ce défaut lui-même : oubli ou manque, conçus non comme fautes mais comme symptômes. C’est une autre approche des troubles de l’apprentissage qui n’est pas incompatible, loin de là, avec les avancées des neurosciences. Dans le cas d’Ysaure, on apprend au cours de l’entretien que sa mère ne lui a jamais parlé clairement de la maladie mentale de son père. Elle a même appelé « bouffées de chaleur » les épisodes délirants du père atteint de schizophrénie, qui a dû quitter la famille et partir en Martinique. Les difficultés de la jeune fille reçoivent alors un autre éclairage car elles reproduisent le malentendu familial : « à cause de l’orthographe j’arrive pas à comprendre les mots difficiles » dit Ysaure, mais quel est le mot difficile, pour elle, sinon celui de schizophrénie ? « Quand j’essaie de dire un mot on comprend autre chose » continue-t-elle, mais n’est-ce pas ce qu’on fait autour d’elle pour parler de la maladie de son père ?
La clinique montre que même la grammaire est affaire de famille, et que la famille elle-même est une grammaire. Qui est le sujet ? Qui est l’objet ? Qui complète qui ? Je pense ici à ce petit garçon, Mathis, qui nous dit que son problème en français, c’est « le COD pronom ». Un petit garçon d’une dizaine d’années, comme Ysaure. Et il ajoute, comme pour expliquer sa difficulté : « c’est le pronom qui change tout ». Durant l’entretien avec sa mère, juste avant, on a appris qu’elle avait perdu une petite fille au 5ème mois de grossesse, avant l’arrivée de Mathis. « On n’a pas pu récupérer le corps » a-t-elle précisé. Et tout à coup, la question de l’apprentissage du français s’approfondit de cette dimension inconsciente à l’oeuvre dans le savoir. C’est un peu comme si Mathis exprimait, dans son rapport à la langue, cette place difficile à vivre pour lui, celle du pronom qui remplace. Inconsciemment, pour ses parents, et dans cet insu qu’il partage avec eux, il est sans doute le pronom de sa sœur morte. C’est pourquoi il fait autant le garçon bagarreur, ingérable en classe - enfant évidemment « dyslexique » et « hyperactif » qui nous confie quand même : « ma mère, elle aurait préféré avoir des filles, les filles elles s’énervent pas tout le temps. » Et, pour conclure, quand on lui demande s’il a déjà confié cette angoisse à ses parents, il murmure : « moi je préfère le garder » (le, pronom COD).
Apprendre c’est toujours une demande d’amour.
Il y a beaucoup d’autres histoires d’enfants, à l’UPPEA et ailleurs, pour qui l’acte d’écrire ou de lire, le fait d’entrer dans les apprentissages réactivent des peurs insoupçonnées auxquelles on peut être sensible à l’école. Que l’élève sache déjà qu’on entend son malaise et qu’on lui donne une place, même en classe, quitte à faire bouger un peu le cadre, pour qu’il puisse cesser de répéter son symptôme. Je suis même persuadée que, dans notre métier d’enseignant-e, qui n’est pas celui de psychologue, ce que nous transmettons de plus vrai, c’est notre propre rapport au savoir, qui n’est pas un stock de connaissances, mais, pour nous aussi, le lieu d’une recherche permanente à laquelle répond en écho la curiosité de l’élève : « Tous les pourquoi ? de l’enfant témoignent moins d’une avidité de la raison des choses, qu’ils ne constituent une mise à l’épreuve de l’adulte, un pourquoi est-ce que tu me dis ça ? toujours re-suscité de son fonds, qui est l’énigme du désir de l’adulte ». (Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse)
Enseigner, c’est d’abord transmettre son propre désir de savoir...
Les autres articles de la rubrique
Dire, écrire, dessiner - en réaction (...)
Confession de foi de Puylaurens
In memoriam Stéphane Hessel (lien)
Mémento de pratique cinématographique (...)
Une société sans pensée utopique (...)
À nous le Maison blanche, dossier
École alsacienne - établissement privé laïc sous contrat d'association avec l'État
109, rue Notre Dame des Champs - 75006 Paris | Tél : +33 (0)1 44 32 04 70 | Fax : +33 (0)1 43 29 02 84