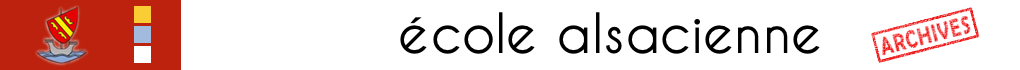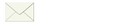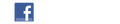Sommaire
Recherche
Connexion
Catonné, Jean-Marie / L’aviateur enterré
L’épopée de la France libre à laquelle Romain Gary participa de 1940 à 1944 et son « appartenance » au groupe de bombardement Lorraine sont au fondement de sa légende. Avant l’écriture, avant la diplomatie, la libération de la France fut sa première promesse tenue, justifiant les sacrifices et les prophéties de sa mère.
Or le récit qu’il en fait dans La Promesse de l’aube est tout sauf légendaire. Le mythe est enterré sous un ton satirique réduisant son aventure à des histoires rocambolesques, à la limite de l’invraisemblance, dont les témoins n’ont pas gardé souvenir.
Pas question d’accuser l’infidélité de la mémoire. Il s’agit d’un travail délibéré de reconstruction littéraire qui met cette guerre démythifiée au cœur des relations entre la mémoire et l’imagination. Dans ce récit prétendu autobiographique, l’imagination l’emporte de loin sur la mémoire.
Inutile également de prendre Gary en flagrant délit de mensonge pour lui faire un procès en mythomanie malgré toutes les approximations et affabulations du récit. Il convient de le lire d’un point de vue esthétique, non psychologique, pour comprendre pourquoi et dans quel sens il retravaille les matériaux pourtant si riches de sa vie réelle.
Dans La Promesse de l’aube, Gary pose lui-même, le problème de son statut littéraire de n’être ni un témoignage historique fiable ni vraiment un roman, quand il écrit qu’un « artiste véritable ne se laisse pas vaincre par son matériau, il cherche à imposer son inspiration à la matière brute [1] ». Prenant à l’époque « encore la vie pour un genre littéraire », il était normal qu’il donne au récit des événements vécus la forme, non d’un récit objectif, mais d’une catégorie esthétique, d’un genre littéraire. « Le talent de ma mère me poussait à vouloir lui offrir le chef-d’œuvre d’art et de vie auquel elle avait tant rêvé pour moi, auquel elle avait si passionnément cru et travaillé [2]. » Ce chef-d’œuvre sera le récit de La Promesse de l’aube plus que les événements bruts qui l’inspirent.
Le “roman” est construit autour de sa mère. Il n’est question de lui que par rapport à elle, et de ses difficultés, voire de son échec, à répondre à son attente, alors que pour la première fois, et définitivement, il se trouve séparé d’elle. Sa mère va donc apparaître sous forme de dibbuk. Absente mais supposée vivante, elle joue, dans sa conscience, le rôle du (bon) dibbuk. C’est elle qui le pousse à la résistance, l’incite à se battre et le sermonne quand il faiblit. « Ma mère […] me suivait partout où j’allais, et sa voix s’élevait en moi avec une cinglante ironie. […] Un peu de tourisme, ça fait du bien ? », lui reproche-t-elle [3] alors qu’il arpente la médina de Meknès.
Son appel est nettement plus déterminant que celui du général de Gaulle : « Sans vouloir compliquer la tâche des historiens, je tiens à préciser que l’appel de ma mère à la poursuite du combat se situe le 15 ou le 16 juin », soit au moins deux jours avant De Gaulle. Dans La nuit sera calme, Gary parlera de « témoin intérieur ». « On peut faire n’importe quoi sans témoin intérieur [4] » ou réaliser des prodiges lorsque ce témoin est une mère comme celle qu’il nous dépeint.
Quels sont les faits qui le mènent de Bordeaux en juin 40 jusqu’aux vols préparant le débarquement en 1944, et sur lesquels Gary imprime son imagination romanesque ?
Il ne va pas directement à Londres et passe par l’aérodrome de Maison-Blanche à Alger, puis par le Maroc où il s’embarque à Casablanca sur un cargo britannique transportant des troupes polonaises. Ensuite Gibraltar, dix-sept jours de voyage sur une mer agitée agrémentée d’une attaque aérienne allemande. Débarquement à Glasgow, et enfin Londres.
Le 8 août 1940, il est incorporé dans les Forces aériennes françaises libres. Nommé adjudant, affecté au groupe de bombardement Topic, ancêtre du groupe Lorraine, il rembarque en octobre 1940 pour l’Afrique.
En quelques mois, il traverse l’Afrique d’ouest en est à partir de l’actuel Ghana puisque Dakar est demeuré vichyste, Maidiguri au Nigeria, Bangui en Afrique équatoriale française, Fort-Lamy au Tchad, puis Khartoum, dans une nature hostile où se multiplient les accidents d’avions et les premiers disparus. Des missions de convoyage, des vols à risque mais pas d’opérations militaires proprement dites. Hasard des affectations, il ne participe ni à la prise de Koufra avec Leclerc, ni aux combats en Libye contre Rommel comme une partie de ses camarades. Il est venu pour se battre et se sent inutile.
« Je tiens donc à le dire clairement : je n’ai rien fait. Rien, surtout, lorsqu’on pense à l’espoir et à la confiance de la vieille femme qui m’attendait. Je me suis débattu. Je ne me suis pas vraiment battu. [5] »
Il remonte ensuite par l’Egypte jusqu’en Syrie où il est à nouveau éloigné des combats par la fièvre typhoïde pour avoir bu des eaux du Chari sur une baleinière en allant de Bangui à Fort-Lamy. Hospitalisé à Damas, il passe plusieurs semaines entre la vie et la mort.
Après des mois de convalescence, ce sont les premières opérations guerrières en Méditerranée depuis la base palestinienne de Saint-Jean d’Acre : protection des convois maritimes, patrouilles contre les sous-marins italiens qu’il minimise dans son récit.
A l’automne 1942, le groupe Lorraine quitte le Proche-Orient pour l’Angleterre en passant par le Cap de Bonne Espérance. Soixante-huit jours en mer. Un des trois navires du convoi est coulé en pleine nuit, torpillé par un sous-marin italien. Retour à Glasgow, puis Hartfordbridge au sud-est de Londres d’où Gary va participer, à partir de 1943, à de nombreuses missions de bombardement. Affecté à l’Etat-major après une grave blessure, il ne participe pas aux opérations du 6 juin.
Au moment du débarquement, il compte 769 heures de vols (n’incluant pas la période de juillet 39 à juillet 40) dont 65 heures de vols de guerre en 26 missions qui lui valent le grade de capitaine.
De 1938 à 1945, il aura ainsi passé plus de sept ans sous les drapeaux. La légende n’est pas usurpée. En témoignent ses deux citations : « Excellent observateur, officier plein d’allant et de courage, a en toutes circonstances vaillamment tenu sa place de navigateur bombardier. […] Le 25 janvier 1944, alors qu’il conduisait une formation de 6 avions, blessé par la D.C.A. d’un éclat d’obus dans l’abdomen et sachant son pilote également blessé, a néanmoins effectué le bombardement et ramené la formation jusqu’à la sortie du territoire ennemi. » Exploit qui lui vaut d’être Compagnon de la Libération dont la citation signale « son cran et son courage. »
Le rapport le proposant au grade de capitaine le désigne comme « un parmi les tout premiers à répondre à l’appel du général De Gaulle en juin 1940. Un de ceux dont le désintéressement et la foi ont tant contribué à la libération de la France. […] Se signale particulièrement lors de l’attaque d’un sous-marin au large de Chypre. » La rhétorique militaire contredit en tous points La Promesse de l’aube où il prétend avoir raté sa cible et en faire aujourd’hui encore des cauchemars !
Epopée héroïque dont il peut être fier – dont sans doute il est légitimement fier – mais qui ne transparaît pas du tout dans La Promesse, aux antipodes de son carnet militaire. A lire même La Promesse comme un témoignage historique sur les Forces aériennes françaises libres, on n’ose imaginer ce que la propagande vichyste aurait pu en faire sous l’Occupation !
Comment et dans quel contexte, selon Gary romancier, on devient un héros de la France Libre… ?
A Bordeaux, sur le terrain d’aviation, premières impressions : il voit un sergent-pilote descendre de son avion accompagné de « ce qui ne pouvait être autre chose que cinq aimables pensionnaires d’une “maison” de province [6] ».
Il a pour camarade un dénommé Belle-Gueule qui a un vrai problème moral : « Il était maquereau dans le civil et sa femme préférée était en maison à Bordeaux. Il avait l’impression de ne pas être régulier avec elle en partant seul [7]. »
Telle la population militaire de cet « étrange Dunkerque aérien [8] » sur l’aérodrome de Bordeaux-Mérignac en juin 1940.
Au Maroc, même atmosphère. Ayant la police militaire vichyste à ses trousses pour tentative de vol d’avion, il décide de passer ses premières quarante-huit heures marocaines dans le bousbir, le quartier réservé de Meknès, « dans le flot ininterrompu des militaires de toutes les armes qui venaient se soulager [9] ». « Tout l’Empire était là [10]. » La France retrouve un semblant d’unité.
Arrive ce qui doit arriver. Dans le bordel de la mère Zoubida où il a cherché refuge, il est en proie à un dilemme cornélien. Refuser de consommer, « cela signifiait l’arrestation et la cour martiale. Il me fallait donc non seulement “consommer”, mais encore “faire un couché”. » Précision historique d’importance : « Il était difficile de se sentir moins inspiré que je ne l’étais dans la circonstance. J’avais vraiment la tête ailleurs [11]. » On le comprend !
Auparavant, il avait proposé le mariage à une barmaid polonaise qu’il connaissait depuis dix minutes, puis demandé la main de la sœur d’un de ses camarades. Cela semble une obsession. Il faut dire qu’il s’attache « très facilement [12] », répète-t-il façon Ajar. En Afrique équatoriale française, il prétendra s’être marié avec une petite africaine de seize ans : « J’allais trouver ses parents et nous célébrâmes notre union à la mode de sa tribu [13]. » Hélas, Louison était lépreuse, il dut s’en séparer. Mars et Vénus à Meknès. Tristan et Iseult à Bangui.
Dans le port de Casablanca, grâce à sa connaissance du polonais, il réussit à s’embarquer avec quelques Français libres sur un cargo britannique transportant des troupes polonaises.
Ils apprennent à Gibraltar que la flotte britannique vient de détruire la flotte française à Mers el-Kébir. Refusant « de demeurer plus longtemps à bord d’un bateau anglais », il se déshabille et plonge dans l’eau en direction d’un navire français. Deux kilomètres à parcourir, une bagatelle, qui lui laissent le temps de rêver, un moment, d’assassiner l’amiral anglais responsable de ce désastre. Y ayant renoncé, il grimpe à bord de « l’aviso battant le pavillon tricolore [14] ».
« Un sergent aviateur était assis sur le pont et épluchait des patates. Il me regarda sortir tout nu de l’eau sans manifester la moindre surprise. Lorsqu’on a vu la France perdre la guerre et la Grande-Bretagne couler la flotte de son alliée, rien ne doit plus vous surprendre.
– Ça va ? me demanda-t-il poliment. »
Le sergent, futur lieutenant-colonel et commandeur de la Légion d’honneur, est enchanté de cette « recrue de plus pour la corvée des patates ». Refusant « d’avoir à me livrer à des travaux ménagers, si contraires à ma nature inspirée. Je lui fis […] un petit geste amical et me replongeai dans les flots ». Voilà comment on débarque en Angleterre avec « d’autres “déserteurs” français [15] » sur un cargo félon.
Inutile d’ajouter qu’aucun de ses camarades n’a gardé le souvenir de cette épreuve de natation où le refus d’éplucher les patates détermine le futur Compagnon de la Libération.
A Londres, il se lie avec un dénommé Lucien « lequel, après plusieurs jours et nuits de noce particulièrement agitée, devait brusquement se loger une balle dans le cœur [16] ». Quant à Gary, il lui arrivait « de boire une bouteille de whisky par nuit [17] ».
Voilà la France libre : des maquereaux, des prostituées, des alcooliques. On est plus près de la propagande vichyste que de la morale de la Révolution nationale.
Chargés en compagnie de deux caporaux de conduire le cercueil du malheureux Lucien jusqu’au cimetière militaire, ils se trompent de caisse, après avoir encore beaucoup bu, et y enterrent une caisse de bière Guiness sous un drapeau tricolore. « Nous ne sûmes jamais ce qu’était devenue l’autre caisse, la bonne [18]. »
Puis il se bat en duel pour une fille avec un officier polonais et s’en tire avec un blâme.
Sur le navire qui le ramène de Glasgow vers l’Afrique, il y a « une centaine de jeunes Anglaises de bonne famille, toutes engagées volontaires », qui, « dans le back-out rigoureusement observé à bord, nous firent la meilleure impression. Comment le bateau n’a pas pris feu, je me le demande encore [19] ».
La jeune fille qui se dévergonde fait partie de la tradition vaudevillesque au même titre que la scène de quiproquo sur le pont du cargo où un adjudant-chef drague Gary en le prenant pour une femme.
On n’en finirait pas de raconter les événements difficilement crédibles de la troisième partie de La Promesse de l’aube. C’est toute la réécriture picaresque de cette fausse épopée de la France libre qu’il faudrait rapporter.
En Afrique, après un accident d’avion qui tue le pilote et le navigateur, il aurait passé trente-huit heures dans la carlingue, au milieu de la brousse, à jongler avec cinq oranges, en un récit très garyen que l’on retrouve dans plusieurs romans, afin de proclamer « la supériorité de l’homme sur tout ce qui lui arrive ».
« Tu m’avais promis de faire attention », lui reproche sa mère.
– Ce n’est pas moi qui pilotais [20] », plaide-t-il.
Toujours éloigné des combats, « détaché avec plusieurs camarades à Bangui […] pour assurer la défense aérienne d’un territoire que seuls les moustiques menaçaient » et supportant mal cette oisiveté, il manifeste contre les autorités militaires en fonçant « en rase-mottes sur un troupeau d’éléphants [21] ». Bilan : deux morts, le pilote et… un éléphant. Plus quinze jours d’arrêt de rigueur.
De rage, il aurait bombardé avec des bombes d’exercices le palais du Gouverneur ! Deux fois en conseil de guerre à cette époque, affirme-t-il dans ses entretiens avec André Bourin [22] alors que dans La Promesse de l’aube il prétend ne pas avoir été puni.
Aucune trace, évidemment, dans son dossier militaire et la mémoire de ses camarades.
En matière de protestation contre son inactivité durant la bataille d’Angleterre, La nuit sera calme [23] offre en prime le récit délirant d’une tentative d’assassinat d’un commandant français pour laquelle il aurait été convoqué par De Gaulle durant l’été 40 !
A l’hôpital de Damas, réellement malade, entre la vie et la mort, il aurait reçu l’extrême onction. Un cercueil ayant déjà été placé dans sa chambre (à ne pas confondre avec une caisse de Guiness), il veut fuir, sort dans le jardin et apparaît « spectre titubant et tout nu, coiffé seulement d’une casquette d’officier » devant un jeune typhique convalescent qui, « le soir même, [fit] une rechute [24] » !
De retour en Angleterre, le récit de sa blessure est en partie banalisé par des préoccupations concernant sa virilité. Le sang coulant sur son pantalon, il s’assure d’une main « que l’essentiel était sain et sauf [25] », on ne sait jamais.
Epopée certes que cette troisième partie de La Promesse, mais épopée burlesque, sans lyrisme guerrier, ne comportant aucun témoignage vraiment historique. On a droit, pour le plaisir du lecteur, à un récit totalement anecdotique, plein d’invraisemblances cocasses. Il faudrait être bien naïf, ou s’abandonner effectivement à la magie de son écriture, pour croire à la véracité de tout ce qu’il raconte.
L’essentiel n’est pas sa participation aux Forces aériennes françaises libres mais son incapacité à répondre à l’appel de sa mère et les multiples obstacles qui l’en empêchent. C’est la chronique des tribulations d’une mère héroïque dans la conscience d’un fils maladroit, toujours en retard sur les événements. C’est Bécassine dans la France libre.
Cet émiettement des anecdotes, leur caractère imaginaire, le ton sur lequel Gary les rapporte, ont un sens. Ce sont les différents épisodes du récit picaresque [26]. Il faut lire La Promesse comme le premier de ses récits picaresques dont il fera la théorie dans Pour Sganarelle. Cela ne remet pas en cause son courage mais témoigne de sa volonté de raconter autrement, d’en faire un conte plus qu’un témoignage. Rien à voir avec le matamore, l’esprit ancien combattant qu’une certaine presse lui prêtait, lui trouvant « sa bravoure et sa virilité en bandoulière ».
Ni chanson de geste, ni épopée lyrique, La Promesse de l’aube enterre une première fois la légende dans une entreprise de démythification au réalisme prosaïque qui est le propre du récit picaresque.
Dans ce pseudo-roman héroïque, le picaro se raconte lui-même, prenant le lecteur à témoin, ironisant sur la leçon de ses malheurs comme dans les romans d’apprentissage. La narration prétendue autobiographique de La Promesse commente ainsi la guerre qu’il a ratée avec un humour qui désamorce le réel, pour en tirer une leçon de relativité sur les vicissitudes de l’existence.
Le roman picaresque est décousu, de forme baroque, trouvant son unité dans les multiples aventures qui se succèdent sans ordre véritable. Le narrateur, par anticonformisme social, est un provocateur qui a maille à partir avec les autorités. Le récit picaresque semble à l’origine de la course-poursuite des films burlesques. Gary aussi connaît de nombreux démêlées avec les autorités militaires, vichystes d’abord, gaullistes ensuite. Il est un déserteur qui se bat en duel, participe à des pugilats, séjourne en prison, passe soi-disant en conseil de guerre, tout en ne manquant jamais d’honorer les dames qu’il croise sur sa route.
Car la route est le véritable foyer du picaro qui mène une vie errante. Ici, ce sont les pistes dans la brousse, les trajets en cargo, les avions qui se crashent à l’atterrissage, une baleinière sur le Chari. Le récit picaresque fait ainsi entrer dans la littérature, au hasard des rencontres, les basses classes de la société (entremetteurs, voleurs, prostituées). On ne s’étonne plus de voir tout l’Empire dans le bousbir de Meknès.
Aucune analyse psychologique. Le héros est un antihéros, sans grande fermeté morale. Sa mère, ici, lui tient lieu de conscience. Sa vérité psychologique est dans ses préoccupations pour les conditions matérielles d’existence, la vie au quotidien aux situations souvent ridicules, voire grotesques. Où dormir pour échapper aux patrouilles ? Comment se vêtir quand on a perdu sa veste de cuir ?
Même sa mère en devient comique comme toutes les mères qui sermonnent leur garçon quand il en a passé l’âge. Et chaque fois qu’il est enfin sur le point de tenir sa promesse, le dibbuk maternel se métamorphose en spectre dénudé en la personne même de Romain Gary. On peut voir là une explication de deux épisodes étonnants, très théâtraux et bien sûr imaginaires, lorsque, dans la rade de Gibraltar, Gary cherche à rejoindre à la nage un bateau français, ou bien, à l’hôpital de Damas, un cercueil déjà dans sa chambre, quand il veut s’en échapper pour reprendre le combat.
Malgré tout, le lecteur se laisse toujours emporter par cette anti-épopée. L’excès de prosaïsme finit par prendre une dimension épique. Il faudrait inventer une nouvelle catégorie esthétique. Un épique prosaïque où le regard satirique, né de l’invraisemblance des situations, l’emporte sur l’étonnement et l’admiration. Le récit de ces événements incroyables en devient “merveilleux”, faisant la substance romanesque de La Promesse et la perplexité des biographes.
On est donc à cent lieux du Joseph Kessel de L’Equipage, de Saint-Exupéry, Jules Roy, Clostermann, voire Malraux avec L’Espoir. Chez Saint-Ex, le ciel renvoie à une métaphysique humaniste, construisant un nouveau surhomme, établissant une fraternité virile entre les combattants. Les aviateurs sont les chevaliers héroïques des temps modernes.
Pour Gary, au contraire, « le ciel n’est pas toujours pur [27] ». Il n’est pas un écrivain de l’aviation. Le genre a remplacé, après la Grande Guerre, l’épopée maritime coulée avec le Titanic. Rien de tel chez Gary. Les centaines d’heures de vol, l’ivresse des grands espaces, l’enfermement dans la carlingue, la solidarité de l’équipage sont étrangement absents. Pas une fois n’est décrit l’état d’esprit du combattant, ni les préparatifs du vol, ni les bombardements. Pour le récit d’une mission du Lorraine, il vaut mieux lire Mendès France [28]. La seule opération vraiment décrite est celle où il fut blessé. Plus de 100 pages pour cette drôle de guerre où il ne participe pas directement aux combats et seulement 10 pages pour les vols de bombardement, dont 2 sont consacrées à Education européenne.
L’aviation pour lui, ce sont les camarades disparus. Pas grand chose sur les autres sauf s’ils sont morts. Si La Promesse est le mausolée construit pour sa mère, la troisième partie est un véritable monument aux morts sur lequel s’inscrivent les noms, qu’il énumère en plusieurs occasions [29], de tous ceux qui lui manquent. Litanie qu’il reprendra dans La nuit sera calme. Le ciel n’est pas celui de la fraternité virile des vivants mais celui, peuplé de solitude, où errent ceux dont il ne reste plus qu’un nom gravé sur la plaque d’une « rue parfaitement dégueulasse [30] » comme celle du commandant Mouchotte.
Un « jour vint enfin où de tous ceux que j’avais connus en arrivant en Angleterre, il ne resta plus que [31] » cinq noms. Voilà pourquoi il choisit « toujours pour errer sur la terre les lieux où il y a assez de place pour tous ceux qui ne sont plus là [32] ».
« Je pense que l’aviation prédispose à l’amour de la terre ; dans le ciel, on est pris de nostalgie pour la base terrestre que l’on a quittée », assure-t-il depuis Los Angeles en 1958. Le lyrisme de Gary serait horizontal plutôt que vertical. Il préfère la steppe ou l’océan à l’azur.
Ces combats où l’homme lutte contre d’autres hommes, Gary en a-t-il gardé d’obscurs remords ? Remords tardifs, jamais personnellement assumés, lui-même ayant toujours affirmé ne rien regretter. Pourtant, on ne participe pas à des dizaines de missions de bombardement impunément quand on est comme lui prédisposé à l’angoisse.
L’héroïsation de l’aviateur a principalement touché, avec l’aéropostale, l’aviation de chasse qui affronte d’autres aviateurs en un combat singulier. Ce n’est pas le cas des bombardiers qui menacent toujours les populations civiles. Les bombardiers font le sale boulot. Guernica a donné le coup d’envoi d’une stratégie délibérée de démoralisation des populations ennemies. Dresde et Hiroshima, souvent cité par Gary, sont des crimes d’aviateurs. La mort venue du ciel fit tellement peur après que Londres et Paris en eurent fait l’expérience, en 1915, qu’il fut question à la conférence de Genève sur le désarmement de 1932 d’interdire les bombardements aériens ! Tel est le contexte moral dans lequel s’inscrit son action.
Problème angoissant qui a obsédé les aviateurs chargés de bombarder leur propre territoire. C’est le cas du groupe Lorraine dont les avions avaient un rayon d’action limité au nord-ouest de la France, à la Belgique et à la Hollande, mettant hors de portée l’Allemagne.
On peut ainsi observer chez Gary une évolution qui va de l’innocence proclamée à la culpabilité rentrée, indirectement affirmée.
« C’est vrai que vous avez bombardé la France ? / – C’est vrai. / – Pourquoi ? / – Pour ne pas tuer de Français. / – Vous n’avez jamais tué de Français ? / – Jamais. Pas même en rêve [33] », affirme l’un de ses personnages au début des années cinquante.
Il faut attendre la guerre américaine du Vietnam pour voir Gary incriminer les bombardements. A doses homéopathiques mais de manière explicite : « Le peuple vietnamien, je l’ai même pas vu, on bombardait à dix mille pieds ! », objecte un des déserteurs d’Adieu Gary Cooper [34]. Le héros de La Tête coupable confesse : « J’ai été atteint, il y a des années, par les mille kilos de bombes que j’ai lâchées sur un village vietnamien [35]. »
Dans La nuit sera calme, il fait dire à François Bondy : « Quand même tu as été de ceux qui ont rasé les villes allemandes… » Ce qui est faux mais peut-être Gary prépare-t-il le dossier d’instruction de Tonton Macoute. Réponse à son hypothétique interlocuteur : « On reparlera de cela plus tard si tu veux… [36] »
Le procès vient deux ans plus tard, éclatant telle une bombe à retardement avec Pseudo qui rompt le silence sous l’identité d’un autre, soit son neveu qui est censé savoir de quoi il parle :
« J’ai un oncle que j’appelle Tonton Macoute, parce que pendant la guerre, il était aviateur et il massacrait les populations civiles de très haut. Il faisait de temps en temps des cures de désintoxication […]. Il venait se désintoxiquer des populations civiles qu’il avait massacrées [37]. »
« Je pensais aux villes allemandes que Tonton Macoute avait bombardées. Des milliers de civils bousillés. Or, dans les maisons qu’il faisait ainsi sauter, il y avait des canaris, des chiens, des chats. Des centaines de petits chats. Il avait dû tuer des milliers de petites bêtes innocentes [38]. »
L’accusation est énorme, terrible. Tonton Macoute est un criminel de guerre !
Gary confirmera dans Les Cerfs-volants que le ciel humaniste et l’enfer terrestre ont des accointances. Le jeune Ludo vit le débarquement en Normandie d’en bas, parmi les cratères de bombes. La Libération est en marche :
« Je n’avais pas encore appris à distinguer le sifflement des bombes d’avions de celui des obus de celui des obus et je mis quelques temps à comprendre que l’enfer venait du ciel, comme il se doit. Plus de dix mille sorties avaient été effectuées ce jour-là par l’aviation alliée au-dessus de la Normandie [39]. »
L’enfer vient du ciel, comme il se doit.
Gary aviateur aura été doublement enterré : démythifié dans La Promesse de l’aube où il ironise sur ses campagnes militaires. Les seuls héros sont des morts et Gary est sorti de cette guerre bien vivant avec son premier chef-d’œuvre, Education européenne, qui le fait naître comme écrivain, pas comme héros de la France Libre :
« Je m’empressais de télégraphier la nouvelle à ma mère, par la Suisse. » Mais « ce qu’elle attendait de moi, tant que la France était occupée, c’était des faits de guerre, ce n’était pas de la littérature [40] ».
Le dibbuk maternel regrettait l’enterrement de l’aviateur héroïque sous l’œuvre de l’écrivain.
Enterré ensuite moralement, exterminé même dans Pseudo avec Tonton Macoute. « Je vous ai déjà dit que Tonton Macoute a été tué à la guerre et que depuis, il s’est bien débrouillé. […] les villes sont pleines de gens qui ont été tués mais qui se sont arrangés pour vivre [41]. »
Tonton Macoute dort en paix dans son blouson d’aviateur. Pas Romain Gary.
Tout ce travail de démythification ne doit pas occulter le courage indéniable de Romain Gary, frisant, comme celui de ses camarades, l’inconscience. La lecture des archives de l’Armée de l’air [42] donne froid dans le dos. Les avions rentrent souvent criblés d’éclats d’obus. D’autres tardent à rentrer dont le Journal de marche du groupe Lorraine note la disparition sur le ton neutre d’un constat de notaire. Un avion manquant, c’est un équipage de quatre hommes. Voilà de quoi sa mémoire est encombrée.
On pense à un autre écrivain également d’origine polonaise, Guillaume Apollinaire, qui s’engagea lui aussi héroïquement comme d’autres immigrés en 1914 pour défendre sa patrie d’accueil.
Mais le parallèle s’arrête là. Ni dans sa vie, ni dans son œuvre, Gary n’a jugé la guerre poétique.
[1] La Promesse de l’aube, Folio, p. 366.
[2] Ibid. p.352.
[3] Ibid. p. 302.
[4] La nuit sera calme, Folio, p. 27.
[5] La Promesse de l’aube, p.357.
[6] Ibid. p. 275.
[7] Ibid. p. 278.
[8] Ibid. p. 277.
[9] Ibid. p. 309.
[10] Ibid. p. 310.
[11] Ibid. p. 313.
[12] Ibid. p. 305.
[13] Ibid. p. 360.
[14] Ibid. p. 321.
[15] Ibid. pp. 322-323.
[16] Ibid. p. 327.
[17] Ibid. p. 328.
[18] Ibid. p. 331.
[19] Ibid. p. 343.
[20] Ibid. p. 355.
[21] Ibid. p. 356.
[22] Romain Gary, Le nomade multiple, Ina / France Culture.
[23] La nuit sera calme, pp. 21-22.
[24] Ibid. p. 366.
[25] Ibid. p. 376.
[26] Cf. Julien Roumette, « L’aventure picaresque et l’auto-dérision » in Etude sur La Promesse de l’aube, Ellipses, pp.55-56.
[27] Cf. Le Figaro, 26 novembre 1976.
[28] Mendès France, Roissy-en-France, postface à Liberté, liberté chérie.
[29] La Promesse de l’aube, pp. 323-324, pp.328-329, etc.
[30] La nuit sera calme, p.108.
[31] La Promesse de l’aube, p.374.
[32] Ibid. p. 281.
[33] Les Couleurs du jour, Gallimard, p. 28.
[34] Les Couleurs du jour, Gallimard, p. 28.
[35] La Tête coupable, Folio, p. 44.
[36] La nuit sera calme, p.44.
[37] Pseudo, Folio, p.28.
[38] Ibid. p. 169-170.
[39] Les Cerfs-volants, Folio, p. 342.
[40] La Promesse de l’aube, p. 375.
[41] Pseudo, p. 70.
[42] Service historique de la Défense, Château de Vincennes, Val-de-Marne.
Les autres articles de la rubrique
Marbeau, Michel / L’Affaire Weidmann,
Colodiet, François / La République et (...)
Catonné, Jean-Marie / Des idées et (...)
Montenot, Jean / Descartes était-il (...)
Ourednik, Patrik / Ma fille a cinq (...)
Colodiet, François / Carnets de (...)
Montenot, Jean / En attendant (...)
Ourednik, Patrik / Les temps sont (...)
École alsacienne - établissement privé laïc sous contrat d'association avec l'État
109, rue Notre Dame des Champs - 75006 Paris | Tél : +33 (0)1 44 32 04 70 | Fax : +33 (0)1 43 29 02 84