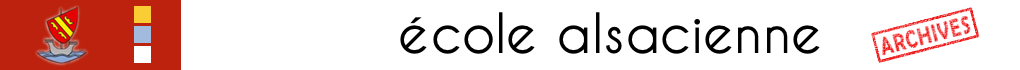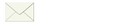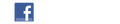Sommaire
Recherche
Connexion
Montenot, Jean / En attendant Beckett
EN ATTENDANT BECKETT
Dublinois, né protestant dans une Irlande catholique, il a commencé à écrire et à publier en anglais, dans les années trente, des essais, un roman, des nouvelles, mais c’est en français qu’il a, au début des années cinquante, rencontré la notoriété. Il a eu une enfance plutôt heureuse, mais comme il l’a confessé lui-même, il avait « peu de disposition pour le bonheur ». Il est issu d’un milieu relativement aisé, mais il a toujours fui l’aisance matérielle et a choisi l’austérité. Servant de traducteur dans un réseau de résistance, il a risqué sa vie pour un pays, la France, qui ne lui a pas épargné les tracasseries administratives, avant de lui octroyer la croix de guerre et la médaille de la Reconnaissance française, mais la rhétorique de l’engagement et de l’authenticité caractéristique de l’après-guerre le rebutait : « abjectes abjectes époques héroïques vues des suivantes » [1]. Bref, Beckett est un « homme séparé », selon le mot de Cioran, qui se tient « à l’écart », qui ne vit pas « dans le temps, mais parallèlement au temps » [2]. Il y a sans doute beaucoup de Beckett dans ce que déclare le narrateur sans identité fixe de L’Innommable : « Oui, dans ma vie puisqu’il faut bien l’appeler ainsi, il y eut trois choses, l’impossibilité de parler, l’impossibilité de me taire, et la solitude, physique bien sûr, et avec ça je me suis débrouillé » [3].
« Saletés de mots »
Beckett s’est donc débrouillé en devenant écrivain. Cela n’allait pas de soi pour un homme qui ne semblait guère croire à la réalité, ni surtout faire confiance aux mots pour la dire. Conviction constamment répétée dans son œuvre. Ainsi, le narrateur du onzième des Textes pour rien : « Nommer, non rien n’est nommable, dire, non rien n’est dicible, alors quoi, je ne sais pas, il ne fallait pas commencer […] Saleté de mots pour me faire croire que je suis là » [4]. Et l’agent Jacques Moran, personnage central de la seconde partie de Molloy (1951), qui se clochardise en recherchant un autre vagabond, le borgne, puant et béquillard Molloy : « Tout langage est un écart de langage » [5]. Ou encore Winnie, la femme de cinquante ans qui a « de beaux restes » et qui s’enfonce dans Oh les beaux jours : « Les mots vous lâchent, il est de moments où même eux vous lâchent » [6]. En dépit de ces préventions contre les pouvoirs du langage ou peut-être à cause d’elles – « Je vais le leur arranger leur charabia » [7] –, Beckett est devenu romancier et dramaturge, si tant est qu’on puisse dans son cas maintenir cette distinction.
« Une orgie de faux êtres »
Le romancier tend – il n’est certes pas le premier, ni le seul – à réduire à presque rien la part du récit dans ses romans, quand il ne la proscrit pas. D’où l’impression d’hermétisme, voire de non-sens ou d’absurdité, qu’on peut éprouver à la lecture de romans déroutants, impressions analogues à celles qu’ont exprimées les critiques d’art face aux premières manifestations de la peinture abstraite ou de la nouvelle musique. Son théâtre suit un mouvement parallèle d’épuration et d’abstraction. Beckett dramaturge réduit l’action aux discours, en réalité aux monologues de personnages dont on se demande même s’ils existent en dehors des mots qu’ils profèrent. Pas moi (Not I, 1973, trad. fr., 1975), pièce expérimentale en un acte, pousse la chose à son paroxysme : il n’y a plus sur scène qu’une « Bouche » qui soliloque. À peine aperçoit-on un « Auditeur » au sexe indéterminé qui se tient silencieux sur l’avant-scène, enveloppé d’une djelabba et d’un capuchon. La plupart des personnages de l’œuvre de maturité de Beckett ont pour trait commun d’être repliés sur eux-mêmes, comme en voie d’effacement à l’instar de leur créateur. Ce sont des indolents, des marginaux, des clochards, des grabataires, des êtres rampants voire immobiles, des crasseux, des édentés, des vieux, des mélancoliques. Une « orgies de faux êtres » [8] que seules quelques manies plus ou moins mécaniques, comme celle de parler pour ne rien dire, rattachent au monde. Bref, des fous, des fous par excès de normalité : « Nous naissons tous fous. Quelques-uns le demeurent » [9] déclare Estragon, l’un des deux clochards d’En attendant Godot (1952). Le « héros » beckettien n’existe que par bribes, par intermittence, dans des morceaux de bravoures « pendant le petit pendant et le bref après » [10], quand ils parlent malgré tout, ou même quand ils se taisent car « ce n’est pas tout de garder le silence, mais il faut voir aussi le genre de silence qu’on garde » [11]. C’est cette étrange parade de spectres humains, cette « galerie de crevés » [12], sortis de l’imagination d’un homme réservé plus que secret qui a valu à cet ascète de la littérature, tout entier voué à l’éclaircissement de ce qui en lui est obscurité, la consécration du prix Nobel de littérature 1969. En dépit du paradoxe apparent d’aborder par la vie l’œuvre d’un auteur qui remet radicalement en cause l’idée qu’on ne puisse jamais rien connaître, c’est néanmoins en retraçant son itinéraire intellectuel qu’on peut le mieux comprendre cet Irlandais qu’une notoriété tardive – il a près de cinquante ans quand Molloy (1951) et En attendant Godot l’arrachent à l’anonymat – n’a pas fait dévier d’une voie qu’il a mis longtemps à découvrir.
Les désarrois de l’élève Beckett
Il est né le 13 avril 1906 à Foxrock, un quartier aisé de la banlieue sud de Dublin. Il a été formé au collège protestant de Protora Royal, puis au Trinity collège. Il y étudie la littérature anglaise, les langues romanes et s’intéresse passionnément aux grands maîtres de la sculpture et de la peinture. Au total, Samuel Beckett est un jeune homme extrêmement brillant et cultivé qui a toutes les qualités requises pour devenir un universitaire et un professeur érudit. Polyglotte, il connaît, outre le latin, le français, l’allemand, l’italien et l’espagnol. Il a lu Kafka en allemand [13], Dante en italien – La Divine comédie est d’ailleurs restée une de ses œuvres de chevet jusqu’à sa mort –, Calderón en espagnol. Ajoutons à cela, celle de versets de l’Ancien Testament, vestiges d’une éducation protestante rigoriste, et bien sûr, une connaissance approfondie de Shakespeare et de John Milton. Les spécialistes n’ont pas fini d’ergoter sur les innombrables réminiscences, volontaires ou non, des lectures de Beckett dans son œuvre. Nommé répétiteur d’anglais à l’École Normale Supérieure, le séjour à Paris est pour lui l’occasion d’approfondir, au contact de Jean Beaufret notamment, sa connaissance de la philosophie classique. Il découvre surtout à Paris une atmosphère de liberté intellectuelle qui tranche avec la rigueur morose de Dublin. Il y rencontre les surréalistes, des poètes et des peintres. Découvre l’alcool aussi. Il se lie avec Joyce dont il a lu l’année précédente les principaux ouvrages et que lui a présenté son prédécesseur à l’E. N. S., Thomas Mac Greevy. Plus qu’un secrétaire parmi d’autres, Beckett devient l’ami et un admirateur de Joyce. Rencontre décisive, même si à l’époque, de son propre aveu, Beckett n’avait pas encore l’intention d’être écrivain. « Ça n’est venu qu’après, quand j’ai découvert que je n’étais pas du tout doué pour l’enseignement » [14].
« La route est longue quand on chemine tout seul »
De retour en Irlande, Beckett a compris assez vite qu’il ne voulait pas devenir professeur. La décision de renoncer à sa carrière universitaire a été prise au grand dam de ses parents. Sa mère, May Beckett, une « mère comico-réelle » selon ses propres dires, se trouve renforcée dans l’opinion que son fils est un incapable. Son père, Bill Beckett, un « père réel » lui, consterné, y voit un coup de tête et une fuite devant ses responsabilités. « Allons, allons, un bon mouvement, voyons, finis de mourir, c’est bien la moindre des choses, après tout le mal qu’ils se sont donné, pour te faire vivre » [15] lit-on dans L’Innommable. En plus d’une bonne dose de culpabilité, voire de honte, cette décision contribue à isoler un peu plus Beckett. Commence une période difficile marquée par ce qu’il qualifie « la ronde des non événements » [16] entre l’Allemagne, Paris et Londres, période ponctuée par un épisode dépressif : « Je suis déprimé, aussi déprimé que doit l’être un chou bouffé par les limaces » [17]. La mort de sa cousine Peggy Sinclair, l’une de ses premières amours, et surtout celle de son père qui « vieillissait avec grâce et philosophie » et qui lui semblait avoir « passé un contrat d’apprentissage avec la grande Faucheuse » [18] achève de dresser un tableau plutôt sinistre des débuts de Beckett dans la vie. Il assiste à l’agonie d’un père qui était alors son principal réconfort et dont les dernières paroles émouvantes sont adressées à son fils : « Bats-toi ! Bats-toi ! »
« En passe d’être quelqu’un »
L’écrivain Beckett avait déjà commencé à publier. D’abord un article à la gloire de Joyce, « Dante…Bruno. Vico.. Joyce », et surtout un essai sur Proust (1931) traduit en français en 1991. Beckett jugeait son Proust pédant et s’est opposé à sa réédition comme d’ailleurs à celle de la plupart de ses premières œuvres. L’essai témoigne cependant de l’influence de l’auteur de la Recherche sur la formation d’écrivain de Beckett. On a pu dire que les personnages de Beckett auraient pu « sortir du monde macabre qui peuple la matinée de Guermantes » [19], ces êtres humains que le narrateur voit déjà un pied dans la tombe. Ils en ont la consistance fantomatique : on peut discerner l’ombre portée du duc de Guermantes dans le personnage du vieillard grabataire, héros éponyme de Molloy. Si les traductions, les poèmes, les préfaces et les essais n’en sont pas vraiment, la première tentative de création littéraire d’envergure de Beckett est un roman assez emberlificoté aux nombreuses indications biographiques plus ou moins cryptées : Dream of fair to middling women (publié en 1992, trois après la mort de Beckett). Le personnage de Belacqua, alter ego de l’auteur, y fait une première apparition. Son nom est emprunté au chant IV du Purgatorio de la Divine comédie. Comme le Belacqua de Dante, celui de Beckett est un personnage nonchalant, indolent, dont la volonté faible en fait un caractère à la fois tragique et comique, un personnage qui attend à ce titre annonciateur des héros de la maturité. Le personnage de Belacqua, image réfractée de Beckett lui-même, est le fil qui relie entre elles les petites nouvelles de More Pricks than Kicks (1934), premier recueil publié et traduit bien plus tard en français sous le titre Bande et Sarabande (1994). Belacqua y est un petit Dublinois, très « joycien ». « Dante et le homard » (Dante and the Lobster), la première nouvelle, relate ainsi la journée du « héros », partagée entre une tartine de pain grillé au gorgonzola, une leçon d’italien, et la destinée fatale et comique d’un homard qui s’agite vainement avant de passer à la casserole. Bien qu’il n’apprécie guère Balzac et avec lui toute littérature dite réaliste, on peut noter que, comme chez Balzac, les personnages de Beckett « passent » d’un roman à l’autre. Fût-ce pour les parasiter, comme s’en plaint le narrateur-personnage de L’Innommable : « Murphy, Molloy et autres Malone, je n’en suis pas dupe. Ils m’ont fait perdre mon temps, rater ma peine, en me permettant de parler d’eux alors qu’il fallait parler seulement de moi, afin de pouvoir me taire » [20]. Quoi qu’il en soit, More Pricks et Murphy, le premier roman de Beckett paru en 1938, sont des tentatives encore trop alambiquées, trop savantes, trop « à la manière de » pour rencontrer le succès. Murphy a même été refusé par quarante-deux éditeurs en deux ans avant de trouver preneur. Transposition légèrement exagérée de la réalité de cet échec, Krapp, l’ivrogne délabré de La Dernière Bande [21] déclare avec humour : « Dix-sept exemplaires vendus, dont onze à prix de gros à des bibliothèques municipales, d’au-delà des mers. En passe d’être quelqu’un ».
« Un tas de tripes sans but »
« En passe d’être quelqu’un ? » En mauvaise passe surtout. L’écrivain et l’homme tournent en rond entre romans ébauchés et romances avortées, voyages et errances. Le retour au bercail auprès d’une mère (1937) qui ne manque pas une occasion de lui reprocher son échec est psychologiquement un désastre : « Je suis abruti de tristesse » [22]. « Maintenant, je me détériore avec la plus grande rapidité. Un insensible amas d’alcool, de nicotine et d’intoxication féminine. Un tas de tripes sans but » [23]. En fait, Beckett consomme peu à peu sa rupture avec l’Irlande. Il doit retourner à Paris pour retrouver ce réel longtemps refoulé, refusé, esquivé. Il va d’abord l’éprouver dans sa chair. Agressé rue Didot par un souteneur éméché, un coup de couteau le blesse gravement et manque de le tuer. Un mal pour un bien. Cet événement réconcilie (provisoirement et autant qu’il était possible) Beckett avec sa mère et lui permet surtout de mesurer au chevet de son lit d’hôpital le courant d’amitié qui, de Joyce à ses amis normaliens d’alors, s’était formé autour de lui. La rencontre de Suzanne Descheveaux, une pianiste de six ans plus âgée que lui, le stabilise quelque peu : « Il y a une Française que j’aime vraiment bien, objectivement, et qui est bonne pour moi. Il n’y aura pas de surenchère sur la bague au doigt » [24]. Quinze plus tard, elle deviendra Mme Beckett. En tout cas, elle croit en son génie. Cruelle ou jalouse, Peggy Guggenheim, alors rivale de Suzanne résume à sa manière la situation en disant « que la différence entre elles deux est qu’elle faisait des scènes et Suzanne des rideaux » [25].
« En français, c’est plus facile d’écrire sans style »
Le réel s’invite une nouvelle fois quand la guerre éclate. Beckett alors en Irlande, pays neutre où il aurait fort bien pu rester à compter les coups, se précipite en France : « Je préférais la France en guerre à l’Irlande en paix ! » L’exode, la participation à un réseau de résistance et la perte d’amis chers l’ont profondément transformé. Ces épreuves l’aident aussi à trouver sa voie comme écrivain. Réfugié à partir de 1942 dans le Roussillon après le démantèlement du réseau de résistance auquel il appartenait, il y écrit son dernier roman en anglais, Watt, qui confine aussi à l’autobiographie déguisée et dont le héros, comme la plupart de ceux des romans de Beckett, ne parvient pas malgré des efforts, plus ou moins comiques, plus ou moins tragiques à coller au réel. Après-guerre, le livre ne trouve d’éditeur ni à Londres, ni à New York. Cet échec est une des raisons de la décision d’écrire directement en français. Plus profondément, le passage au français est un moyen de se déprendre du « bon anglais », de sa « propre langue » qui est « comme un voile qu’il faut déchirer en deux pour parvenir aux choses » [26]. En finir avec la métaphore et la rhétorique et rendre possible une écriture minimaliste plus conforme à un projet dont il commence percevoir les contours : « (En anglais), on ne peut s’empêcher de faire de la poésie ; en français, c’est plus facile d’écrire sans style ». Cela n’a pas empêché Beckett de revenir par la suite à l’anglais, pour traduire ses propres œuvres, mais aussi comme langue de création littéraire, comme dans Worstward Ho (1983) (Cap au Pire, 1991) où il se sert « des propriétés qu’il accordait au français pour réinventer un nouvel anglais ‘affaibli’ » [27].
« La vision, enfin » ?
C’est pendant cette période agitée que Beckett prend conscience de ce qu’il veut faire : il comprend qu’il est à lui-même la matière de ses livres, que tout doit venir de lui-même, du dedans. Désormais ses ouvrages seront l’expression sans fard de ce chaos intérieur et le monologue, l’instrument principal de son écriture. Pour cela, nul besoin de personnages aux contours fixés, ni de comédie humaine à la Balzac, qui contraignent l’auteur à se faire le jouet de ses propres créations. On se plait à rapporter cette prise de conscience à une expérience réelle qui se serait produite lors d’un séjour en Irlande en 1946. On en trouverait la transposition littéraire dans la « vision » prêtée à Krapp dans La Dernière bande : « Spirituellement une année on ne peut plus noire et pauvre jusqu’à cette mémorable nuit de mars au bout de la jetée, dans la rafale, je n’oublierai jamais où tout m’est devenu clair. La vision, enfin. […] Ce que soudain j’ai vu alors, c’était que la croyance qui avait guidé toute ma vie […], clair pour moi que l’obscurité que je m’étais toujours acharné à refouler est en réalité mon meilleur » [28]. Beckett précise dans un entretien avec son biographe que si vision ou révélation il y eût, celle-ci eût lieu « dans la chambre de [sa] mère » [29]. En fait, elle n’aurait pas eu le caractère agité et romantique que suggère sa version littéraire. Beckett prend seulement acte de sa limitation : « J’ai pu penser à Molloy et aux autres le jour où j’ai pris conscience de ma folie. Ce n’est qu’à dater de ce moment que je me suis mis à écrire les choses telles que je les sens. » [30] C’est là peut-être le vrai point de retournement, le moment où Beckett naît à lui-même comme écrivain créateur, celui où il se débarrasse de toute libido sciendi, laisse en arrière tout ce qui le détournait de sa voie : « J’ai réalisé que j’allais moi [par opposition à Joyce] dans le sens du retranchement, de la soustraction, plutôt que de l’addition » [31]. C’est en tout cas l’une des clés de lecture de l’œuvre. Beckett, à partir de ce moment renonce aux techniques narratives alambiquées, aux citations érudites contrôlées, aux constructions savantes. Il ne parlera plus « que de la pauvreté, de l’échec, de l’exil et de la perte » [32]. Une fièvre créatrice s’empare alors de lui. Elle est à l’origine de ses premières nouvelles en français et surtout de la trilogie romanesque : Molloy, commencé en 1947, Malone meurt écrit en 1948, L’Innommable commencé en 1949 après qu’il eut entre-temps terminé sa première pièce importante et qui est demeurée la plus connue, En attendant Godot. « Bizarre après tant d’années passées à s’exprimer en aveugle, ce sentiment de se comprendre à la perfection » [33].
« Trouver une forme qui accommode le désordre »
Les romans et le théâtre de Beckett sont un peu au roman et au théâtre classiques ce que les géométries non euclidiennes sont à la géométrie euclidienne. Les repères spatio-temporels de la fiction classique y sont délibérément brouillés, voire effacés : « Écarter une fois pour toutes, […], toute idée de commencement et de fin » [34]. L’identité des personnages est flottante, mise en question, dilatée à l’extrême comme celle de Molloy ou effacée comme dans L’Innommable. « Je. Qui ça ? » [35]. Le narrateur est destitué de la position de surplomb « extérieure aux aventures dites [où il] bénéficie d’une omniscience parfaite », [36] comme c’est encore le cas dans Murphy. À partir de Watt, le narrateur devient un témoin parmi d’autres et les personnages deviennent leurs propres narrateurs. La part belle y est faite aux obscurités et aux contradictions, aux paradoxes, aux apories : les textes de Beckett donnent le plus souvent à voir des êtres qui sont pris dans la contradiction de ne pouvoir parler et de ne pouvoir se taire. Ils ont nourri des commentaires qui oscillent entre interprétations formalistes et interprétations métaphysiques. Il est probable que la plupart tombent sous le coup de la réflexion de Moran confronté au désir parricide qu’il prête à son fils : « ce qui est terrible dans ces affaires-là, c’est que lorsqu’on a envie on n’a pas les moyens et inversement » [37]. Beckett, lui, s’est efforcé jusqu’à sa mort, en 1989, de concilier souci de la forme, compositions complexes voire abstraites, musicales et envie de dire. À ce titre au moins, Beckett, qui a bien des égards passe pour avoir opéré une rupture esthétique radicale en littérature, demeure un classique.
Article paru dans Lire, avril 2006
[1] Samuel Beckett, Comment c’est, Minuit 1961, p. 30.
[2] Emile Michel Cioran, « Quelques rencontres » dans Cahier de l’Herne Samuel, Beckett, LdP Biblio, Essais, p. 45.
[3] Samuel Beckett, L’Innommable, Minuit, 1953 p. 183.
[4] Samuel Beckett, Textes pour rien, Minuit, 1958, p. 190.
[5] Samuel Beckett, Molloy, Minuit, 1951 p. 158.
[6] Samuel Beckett, Oh les beaux jours, Minuit, 1963 p. 30, voir aussi : « Même les mots vous lâchent, c’est tout dire. C’est le moment où les vases cessent de communiquer, vous savez les vases », Nouvelles et textes pour rien, Minuit, 1958.
[7] Samuel Beckett, L’Innommable, Minuit 1953, p.63.
[8] Samuel Beckett, Comment c’est, Minuit, 1961, p. 26.
[9] Samuel Beckett, En attendant Godot, Minuit, 1952, p. 87.
[10] Samuel Beckett, En attendant Godot, Minuit, 1952, p. 87.
[11] Samuel Beckett, L’Innommable, Minuit 1953, p.37.
[12] Samuel Beckett, Molloy, Minuit, 1951 p. 187.
[13] Propos rapporté dans le New York Times du 6 mai 1956.
[14] Entretien avec James Knowlson, 27 oct. 1989, dans James Knowlson, Beckett, Actes Sud 1999, p. 154.
[15] Samuel Beckett, L’Innommable, Minuit 1953, p.19.
[16] Cité par James Knowlson, Beckett, Actes Sud 1999, p. 232.
[17] Samuel Beckett à Thomas MacGreevy, 4 août 1933.
[18] Samuel Beckett à Thomas MacGreevy, 23 avril 1932.
[19] Margherita S. Frankel, Beckett et Proust : le triomphe de la parole, dans Cahier de l’Herne Samuel, Beckett, LdP Biblio, Essais, p. 218.
[20] Samuel Beckett, L’Innommable, Minuit 1953, p.28.
[21] Samuel Beckett, La Dernière bande, Minuit, 1958 , p. 28.
[22] Samuel Beckett à Thomas MacGreevy, 7 juin 1937.
[23] Samuel Beckett à Arland Usher, 15 juin 1937.
[24] Samuel Beckett à Thomas MacGreevy, 18 avril 1939.
[25] James Knowlson, Beckett, Actes Sud 1999, p. 387.
[26] Lettre à Axel Kaun, juillet 1937.
[27] Pacale Casanova, Beckett, l’abstracteur, Seuil, 1998, p. 162.
[28] Samuel Beckett, La Dernière bande, Minuit, 1958 , p. 22-23.
[29] James Knowlson, Beckett, Actes Sud 1999, p. 453.
[30] James Knowlson, Beckett, Actes Sud 1999, p. 453.
[31] James Knowlson, Beckett, Actes Sud 1999, p. 453.
[32] James Knowlson, Beckett, Actes Sud 1999, p. 453.
[33] Lettre à Thomas MacGreevy, 13 mars 1948.
[34] Samuel Beckett, L’Innommable, Minuit 1953, p.63.
[35] Samuel Beckett, L’Innommable, Minuit 1953, p. 83.
[36] Gérard Durozoi, Beckett, Bordas, 1972, p. 136.
[37] Samuel Beckett, Molloy, Minuit, 1951 p. 178.
Les autres articles de la rubrique
Marbeau, Michel / L’Affaire Weidmann,
Colodiet, François / La République et (...)
Catonné, Jean-Marie / Des idées et (...)
Montenot, Jean / Descartes était-il (...)
Ourednik, Patrik / Ma fille a cinq (...)
Colodiet, François / Carnets de (...)
Ourednik, Patrik / Les temps sont (...)
Colodiet, François / Mai 68 : les (...)
École alsacienne - établissement privé laïc sous contrat d'association avec l'État
109, rue Notre Dame des Champs - 75006 Paris | Tél : +33 (0)1 44 32 04 70 | Fax : +33 (0)1 43 29 02 84