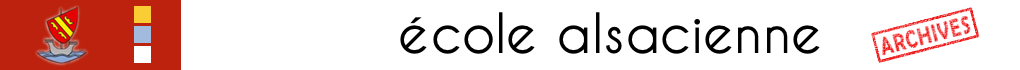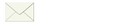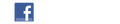Sommaire
Recherche
Connexion
Catonné, Jean-Marie / Queneau ou la philosophie recyclée
L’imagination du romancier du xxe siècle se nourrit de pensées philosophiques. Il est tout à fait symptomatique de voir Marcel Proust, interviewé par le journal Le Temps pour Du côté de chez Swann, ne parler ni de l’histoire ni des personnages, mais de sa méthode narrative, de la « substance invisible du temps », et de ses thèses sur la mémoire involontaire. Curieuse présentation qui risque de rebuter le lecteur avide de divertissement et à qui l’auteur donne en pâture l’ébauche d’un traité de psychologie ! « Mon livre serait peut-être comme un essai d’une suite de "Romans de l’Inconscient" : je n’aurais aucune honte à dire de "romans bergsoniens", si je le croyais [1]. » Heureusement, il ne le croit pas, non parce qu’il s’agit d’un roman mais parce qu’il prétend ne pas retrouver dans le bergsonisme cette distinction entre la mémoire involontaire et la mémoire volontaire qui domine son oeuvre.
Une grande partie de la production romanesque de notre siècle, de Proust à Sartre en passant par Gide, Malraux, Camus, Tournier, sans parler du Nouveau Roman, puise une part de son inspiration, hors du sentiment ou du document, dans une conception intellectuelle - schéma psychologique, idée abstraite, simple vision du monde ou philosophie de l’existence - comme si au dialogue, à la thèse, à l’essai et à la méditation, il convenait d’ajouter un nouveau genre philosophique : le roman moderne [2].
Rien à voir avec le roman à thèse, platement didactique, où l’idée pervertit le roman qui lui-même discrédite l’idée, ce qui suffit à exclure de cette modernité Paul Bourget, Simone de Beauvoir et quelques autres partisans d’une littérature engagée, militante ou utilitaire. Il est question d’authentiques créateurs, de romanciers-nés, non de philosophes ratés, mais dont l’imagination transcendant l’expérience vécue va butiner du côté de chez Freud, de Bergson ou de Heidegger, ce que les artistes d’autrefois allaient chercher dans la Bible, la mythologie antique ou les moeurs de leur temps.
Sauf qu’il s’agit ici d’idées, de pensées, et qu’il est assez peu courant d’en faire un motif d’inspiration, un grenier à fictions.
Pas question non plus de réduire ces oeuvres à leur dimension conceptuelle comme certaines fables à leur morale, ni de céder à cette tentation universitaire qui faciliterait le travail critique en substituant à l’artifice du récit son contenu idéologique : la philosophie d’une oeuvre n’éclaire jamais que des platitudes, impuissante à saisir le relief des mots. Le secret de A la recherche du temps perdu n’est pas dans Bergson - dont Proust d’ailleurs cherche à se distancier - et Nietzsche n’exerce une influence prédominante sur la littérature des premières décennies de notre siècle que parce que sa « pensée » se présente sous forme de mythes et ne constitue pas vraiment un système.
L’art n’est pas dans le concept, et il ne suffit pas d’épouser l’existentialisme philosophique pour écrire La Nausée. Mais la sensibilité créatrice moderne, à mi-chemin de la pensée pure et de l’émotion brute, associe, en une synthèse imperméable à la raison, l’expérience et son sens, les sens à la conscience - et chez les plus grands « la plus frémissante sensibilité, la plus profonde intelligence », comme le disait Proust de Baudelaire [3] -, en allant piocher dans les idées et dans l’univers de la pensée matière à fiction. « Un grand romancier peut ne connaître que quelques philosophes, par extraits, par son professeur, peu importe », écrit Jean-Yves Tadié. L’essentiel n’est pas tant la pensée philosophique qu’il adopte que ce qu’il en fait après se l’être appropriée, et l’avoir parfois déformée. « Lectures attestées ou non, il y a un air philosophique du temps » [4], inséparable de la création romanesque contemporaine, qui fait de quelques romans phares, véritables bibles du XXe siècle tournant le dos à la tradition réaliste, des oeuvres non « d’observation mais de construction intellectuelle » [5].
Quitte à faire en même temps le procès de l’intelligence conceptuelle comme Proust dans la préface du Contre Sainte-Beuve, en reprenant en l’occurrence les analyses de Bergson...
L’oeuvre de Raymond Queneau dont on souligne à plaisir l’évidente intellectualité – quand on n’en dénonce pas la trop grande cérébralité – pousse presque jusqu’à la manie cette prolifération de la philosophie dans l’oeuvre de fiction. Sa culture encyclopédique l’y prédispose ainsi que sa formation, mais surtout sa volonté de s’effacer, de disparaître derrière son oeuvre et de la soumettre aux contraintes du récit objectif, existant par lui-même, sans s’abandonner aux facilités de l’effusion lyrique ou du témoignage par trop autobiographique. Des romans autonomes, travestissant sa pensée et ses émotions, possédant leur propre rhétorique, comme une prosodie sans laquelle l’écriture n’est qu’une addition de lettres et de mots creux, et le roman, un simple avatar du journal intime. On sait que dans Bâtons, chiffres et lettres Queneau s’est longuement attardé sur la structure de ses premières ceuvres – préoccupations qu’il a lui-même qualifiées d’arithmomaniaques – et qu’il lui avait « été insupportable de laisser au hasard le soin de fixer le nombre des chapitres de ces romans » [6] ainsi que la répartition des personnages. On sait moins que ce pythagorisme se double du souci de reprendre à son compte – et de son point de vue, détourné, distordu par l’humour –, un certain nombre de « thèmes » philosophiques, pensées conceptuelles abstraites, qui constituent comme le fond de son ceuvre dont il exploite le gisement, au point qu’il y aurait là comme un procédé systématique de création qui ferait virer ses romans à la pure allégorie si l’on était toujours capable d’en percevoir le sens.
Ainsi au début du Chiendent, comme le germe d’un récit qui va accoupler les personnages et faire rimer les situations, il y a un homme qui en observe un autre. Ou plutôt une conscience qui saisit une apparence, simple silhouette choisie parmi des milliers d’autres, sans épaisseur ni consistance, profil, ombre projetée dans le champ perceptif d’un observateur attablé à la terrasse d’un café. Quelle est cette silhouette sans réalité ni identité qui a tout juste été distinguée dans le théâtre de la rue, avant d’être avalée par une bouche de métro ? Et quel est cet observateur qui voit apparaître et disparaître ces milliers de formes anonymes pour en élire une ? Et pourquoi saisit-il celle-ci plutôt que celle-là ? Drôle de début pour un roman dont on n’ose imaginer le prière d’insérer : dès le premier chapitre, l’auteur s’est efforcé de reproduire localement, aux abords de la gare du Nord, la découverte du cogito de Descartes telle qu’on peut la suivre dans les Méditations I et II, ou, pour être plus précis, le point de vue intersubjectif bien connu de la phénoménologie de Husserl...
Cette silhouette réapparaîtra pour prendre progressivement consistance, devenir quelque chose de plus qu’une simple apparence, un « être plat » puisi un être de « réalité minime », enfin quelqu’un avec une conscience de soi et un nom, Etienne Marcel, et cela après avoir suivi tout un cheminement affectif, s’être étonné de la présence de petits canards flottant à l’intérieur d’un chapeau imperméable dans la devanture d’un chapelier, s’être indigné de l’assassinat de son chat, avoir failli se faire écraser par un taxi dans lequel se trouvait « son » observateur qui lui-même cessera à son tour d’être anonyme pour devenir son ami, un vague alter ego :
« — Au début, vous n’étiez qu’une silhouette ; vous alliez de la banque au métro et du métro à la banque ; c’est alors que je vous remarquai. Un jour vous fîtes un détour et vous devîntes un être plat. [...]
— Cette transformation, inutile de vous le dire, accrut l’intérêt que je vous portais déjà. Un jour, j’étais assis en face de vous, dans un train : je vous vis vous gonfler légèrement. Vous veniez d’acquérir une certaine consistance ; mais personnellement j’en ignorais la cause. Lorsque mon taxi vous tamponna, vous en étiez toujours au même état. Mais lorsque je vous revis, au restaurant, vous vous en souvenez sans doute, vous vous présentiez sous l’aspect que vous possédez encore : celui d’un homme, et qui pense. » [7]
Né du projet (avorté) de traduire en français parlé le Discours de la méthode de Descartes, Le Chiendent reprend très librement l’odyssée cartésienne de la conscience s’élevant de l’existence douteuse à la certitude de soi, ou plutôt la démarche plus neuve, plus récente, de la phénoménologie husserlienne puisque cet objet de conscience, d’abord banale apparition dans le champ perceptif de l’observateur, va grossir, s’épaissir, mûrir pour devenir un autre sujet, comme si Queneau avait d’emblée - soit dès les premières lignes - voulu souligner l’intersubjectivité fondatrice de la réalité humaine renvoyant toute conscience à son vis-à-vis, et qu’il n’est de cogito possible, de sujet pensant, que tourné vers un objet extérieur. Ce même Etienne Marcel cessera d’exister, s’amenuisant jusqu’à retrouver sa primitive apparence de silhouette noyée dans la multitude dès lors qu’il ne sera plus sous le regard de cet observateur qui s’éloigne de lui comme pour sortir du roman, ce qui permet à Queneau de boucler son récit aux allures de sotie sur la même phrase par laquelle il l’avait entamé : « La silhouette d’un homme se profila ; simultanément des milliers, des milliers. Il y en avait bien des milliers. »
Cette sensation d’amenuisement, de diminution, Etienne Marcel l’éprouve également lorsqu’il s’interroge sur le sens du monde et de l’existence en général. Non sur sa propre existence, mais l’existence dans sa totalité. Question métaphysique par excellence qui donne lieu à un surprenant dialogue romanesque avec un dénommé Saturnin :
« — Vous ne trouvez pas que le néant imbibe l’être, disait celui-ci à celui-là qui répliquait :
— L’être ne conjugue-t-il pas plutôt le néant ? », comme en écho aux thèses de Heidegger dont Queneau avait vraisemblablement pris connaissance dès 1931.
Ainsi, expérimentant la toute-puissance de l’ennui qui est le révélateur de l’existant dans son ensemble, Etienne Marcel voit « l’existence per[dre] toute valeur ; les choses toute signification - et ce n’était pas seulement cette existence se présentant ici même qui perdait toute valeur ; ce n’était pas seulement ces choses ici même qui se dépouillaient de toute leur signification, mais aussi cette existence qui était derrière et au-dessus et là-bas, et toute chose qui se situait ailleurs et au-delà et partout. L’univers pressé comme un citron ne lui apparaissait plus que comme une pellicule infiniment mince à laquelle il ne pouvait (voulait ou savait) adhérer [8] ». Et lui-même a l’impression de se dissoudre, de s’anéantir. Heidegger écrivait dans Qu’est-ce que la métaphysique ? : « L’ennui profond, essaimant comme un brouillard silencieux dans les abîmes de la réalité humaine, rapproche les hommes et les choses, et vous-mêmes avec tous, dans une indifférenciation étonnante. » [9] Etienne Marcel vit cette indifférenciation généralisée qui annule jusqu’à sa propre conscience d’être.
Les thèmes heideggeriens [10] de la banalité quotidienne, de la dictature du On, reviennent trop souvent pour n’en pas apparaître comme une explicite illustration, confirmant le projet quenien de « poursuivre le rêve supérieur de l’application de la métaphysique au roman », comme il l’écrit lui-même dans une note de lecture [11].
Quant au dénommé Saturnin - romancier à ses heures, ce qui n’est pas vraiment un hasard -, il occupe ses loisirs à discourir sur l’être et le « nonnête », vu que la philosophie a fait « deux grands oublis ; d’abord elle a oublié d’étudier les différents modes d’être, primo ; et ce n’est pas un mince oubli. Mais ça encore c’est rien ; elle a oublié c’qu’est le plus important, les différents modes de ne pas être ». [12] Parodie évidente du Sophiste et du Parménide de Platon établissant que le non-être n’est pas contraire à l’être mais seulement quelque chose d’autre.
Passons sur le long discours de la jeune Ernestine au moment de mourir, probable réminiscence du Phédon, encore que les considérations des agonisants sur la vanité de l’existence appartiennent à une trop riche tradition littéraire et philosophique pour qu’on puisse leur assigner tel modèle plutôt que tel autre.
Platon, Descartes, Husserl, Heidegger, tel est l’aride terrain sur lequel pousse le chiendent d’une imagination qui cherche à traduire le malheur des hommes dans le naufrage des grandes pensées. On a l’impression que, traumatisé par sa rupture avec le surréalisme, désemparé par l’énormité de ses complexes, Queneau le pudique joue de toute sa (récente) culture philosophique comme d’un refuge pour masquer, et exhiber, son propre désarroi. Faute d’exploiter ses « malheurs » personnels comme il le fera dans Les Derniers Jours, un roman largement autobiographique, Queneau puise dans la philo[sophie] géné[rale], moins engageante, plus impersonnelle, un canevas de concepts susceptibles d’extérioriser, en l’universalisant, sa détresse existentielle d’intellectuel « binoclard » [13]. Réflexions sur l’existence en général qui exclut pour l’instant celle des poissons ou des crustacés, et non matière ou prétexte à raconter sa vie. Et cela, quitte à exercer très défensivement son ironie et se distancier - pudeur ou modestie ? - de ces funambulesques exercices métaphysiques puisqu’il choisit le ton de la farce et de la parodie pour étaler tout ce savoir. Philosophie repensée dérisoirement de l’intérieur, mais philosophie vivante et bien éloignée de celle enseignée à la Sorbonne, étranglée dans le programme des certificats de licence. Le Chiendent est un authentique roman métaphysique, même s’il l’est souvent comiquement.
Le détournement. du discours philosophique n’est pas une exception propre à son premier roman. Chez Queneau la pensée abstraite détermine l’imagination au point d’apparaître comme un véritable tic, un procédé de création, voire de fabrication, comme d’autres s’adonnent au gros rouge, ou font des recherches à la BN, afin de trouver l’inspiration. Gueule de pierre, son second roman et future première partie de Saint Glinglin, s’ouvre sur une méditation angoissée portant sur le mode d’existence animale, la vie que vivent les poissons d’aquarium, les homards ou les poissons cavernicoles rendus aveugles par l’obscurité (allusion à la caverne de Platon ?), vie étrangère à l’existence humaine, au Dasein comme on le fait dire à Heidegger quand on ne sait pas par quoi traduire sa pensée. C’est la même réflexion inquiète sur le sens de l’existence qui se poursuit depuis Le Chiendent, cette fois-ci au travers des formes les moins humaines, les plus inhumaines de la vie.
Si Le Chiendent phagocyte la phénoménologie, Gueule de pierre est un roman ethnologique où Queneau s’approprie l’Essai sur le don de Marcel Mauss et Totem et Tabou de Sigmund Freud. Il y dépeint les curieuses moeurs d’une ville de province symboliquement baptisée la Ville Natale, sur laquelle règne un maire autoritaire et populaire, encensé par une petite cour de lèche-bottes, et qui se double d’un père dominateur et tyrannique, courtisant toutes les femmes, et même sa future bru - séquestrant sa propre fille dont ses fils ignorent jusqu’à l’existence. « Un père violent, jaloux, gardant pour lui toutes les femelles et chassant ses fils à mesure qu’ils grandissent », tel est l’hypothétique état primitif de l’humanité qu’imagine Freud dans Totem et Tabou. « Un jour, les frères chassés se sont réunis, ont tué et mangé le père, ce qui a mis fin à l’existence de la horde paternelle. » [14] Gueule de pierre est le récit de la rébellion des fils contre le père, de la haine immodérée du flls humilié qui passe pour un demeuré et doit tuer le père pour que triomphe la Vérité que ce dernier ne veut pas entendre. Et qui rêve de lui faire sortir « les boyaux de la bedaine, [à son] paternel, et je les ferai sécher sur les rochers / Et les oiseaux rapaces viendront dévorer ton ceur et ton foie blêmes / Ah que tu crèves ! que tu crèves ! toi qui veux mon silence ! toi qui veux me châtrer ! » [15]. On voit qu’ici Queneau ne recule aucunement devant l’exploitation littérale du complexe d’OEdipe, au risque d’amoindrir, par la lourdeur de la thèse et l’absence notoire d’humour, la crédibilité de son personnage. « La bande fraternelle - poursuit Freud -, en état de rébellion, était animée à l’égard du père des sentiments contradictoires qui, d’après ce que nous savons, forment le contenu ambivalent du complexe paternel chez chacun de nos enfants et de nos névrosés. Ils haïssaient le père, qui s’opposait si violemment à leur besoin de puissance et à leurs exigences sexuelles, mais tout en le haïssant ils l’aimaient et l’admiraient. » [16]. Cette ambivalence affective ressort dans les dernières pages du chapitre III (qu’on retrouve à l’identique dans Saint Glinglin). Le père, que les fils ne tuent pas mais qui tombe dans une source pétrifiante qui le transforme en statue de pierre, ce père statuflé, minéralisé, va devenir un dieu, un « Grand Minéral » ttémique, « et la Ville Natale aura son dieu, son dieu de pierre ». [17]
Voilà comment naissent la morale et la religion selon Freud, via Queneau qui semble ici plus appliqué qu’inspiré dans le recyclage des concepts. Et ce n’est pas tout : le jour de la Saint-Glinglin, fête commémorative de la Ville Natale, les notabilités, dont le maire, rivalisent à qui détruira, brisera le plus de vaisselle possible, de la qualité la plus belle et dans la quantité la plus grande, en une cérémonie agonistique qui s’inspire des destructions de richesses que l’on observe dans le potlatch, cette cérémonie indienne que venait d’étudier Marcel Mauss. Ce que certains croyaient sorti de l’imagination burlesque de Queneau reprenait, en fait, des analyses parues dans L’Année sociologique et dont il faisait une pièce maîtresse du deuxième chapitre de son roman. Comme quoi la lecture de Queneau requiert du lecteur autant de savoir que de sensibilité !
Platon, Descartes, Freud, Husserl, Heidegger, Mauss - auxquels il conviendrait d’ajouter l’inévitable René Guénon dont la critique quenienne actuelle [18] privilégie l’influence, notamment dans Odile, Le Voyage en Grèce, Morale élémentaire, mais qui relève plus de la croyance que de la connaissance - tels sont les socles et les matériaux avec lesquels Queneau édifie son oeuvre. A ceux-là, il faut ajouter Hegel dont Alexandre Kojève [19] a souligné qu’il était la clé de Pierrot mon ami, Loin de Rueil, et bien évidemment du Dimanche de la vie qui s’y réfère explicitement ; oeuvres que Kojève considérait comme autant de romans de la sagesse [20] illustrant, par anti-héros interposés, cet improbable état de l’humanité qu’aucun souci, aucun malheur ne peut plus atteindre, une fois parcourue la totalité du mouvement dialectique de l’Histoire. Fameux, fumeux concept de « fin de l’Histoire », plus kojévien peut-être qu’hégélien, et que Pierrot, Louis-Philippe des Cigales et Valentin Brû illustrent de façon dérisoire, sous la forme d’une sagesse plus proche (du moins pour ce dernier) de l’ignorance béate que du Savoir absolu.
Cependant, dans ces romans prétendument hégéliens et qui appartiennent au Queneau de la maturité, celui-ci n’est plus prisonnier de ses modèles conceptuels. Ses héros n’ont pas besoin de Hegel pour exister quand le fatras des incantations de Gueule de Pierre appelle obligatoirement une lecture freudienne. Ce n’est pas la « fin de l’Histoire » qui explique Pierrot mais ce dernier qui éclaire celle-ci. À sa manière. En lui donnant forme, objectivation concrète, singulière, voire très particulière. Ces personnages typiquement queniens ne sont pas de simples marionnettes philosophiques dont les ficelles seraient mécaniquement tirées par l’étudiant Raymond Queneau des années vingt. Ils existent d’abord par eux-mêmes, sans le substrat conceptuel auquel il serait tentant de les réduire. De même qu’il affirme s’être progressivement détaché de son arithmomanie pour déterminer la structure de ses oeuvres, on peut observer une égale distanciation, une plus grande liberté, dans l’exploitation de ses références philosophiques. Certains épisodes du Chiendent exigent un commentaire métaphysique si l’on veut vraiment les comprendre, le lecteur du Dimanche de la vie peut tout à fait ignorer la pensée de Hegel et s’en porter très bien.
Car si Queneau recycle une partie de sa culture philosophique et nombre de ses lectures dans une oeuvre aux allures allégoriques - et c’est encore vrai de ses derniers romans comme Les Fleurs bleues - Queneau ne se veut pas philosophe. Il a souvent affirmé se méfier de l’esprit de système comme du rationalisme intégral. Rien de moins dogmatique, et de plus sceptique, que cet intellectuel. Philosophe certes, dans la mesure où il a le goût des idées et se méfie des sentiments, et où, refusant de prendre la réalité pour ce qu’elle est, il a toujours cherché une voie, une sagesse, une réponse à l’irrecevable existence humaine, en quête d’une improbable gnose. Mais pas au sens où seuls le concept et l’idée compteraient. D’ailleurs, les idées, il s’en moque, il les bouscule, il les banalise, en leur donnant pour emblèmes de burlesques personnages, assez caricaturaux. Il voudrait les ridiculiser qu’il ne s’y prendrait pas autrement, même si chez lui « la parodie n’entraîne pas la dérision absolue, mais plutôt la reprise, l’utilisation ironique et rieuse [...] de thèmes philosophiques. »
« La parodie introduit une distance de l’auteur à l’égard du thème qui est objectivé et dépouillé de son poids de faux sérieux », comme l’explique Claude Simonnet. [21] Queneau se veut avant tout romancier (et poète). Ecrivain. Fabulateur. L’écriture est sa vraie culture. Pas besoin pour justifier l’art et ses artifices de recourir à Husserl ou à Heidegger. On ne fait pas un roman mais seulement de la mauvaise psychologie avec le freudisme, et Freud ici n’est pas en cause, de même qu’il n’est pas nécessaire de lire L’Etre et le Néant de Sartre pour comprendre La Nausée. Leurs dates de parution en font foi. Le tour de force de Queneau (tour de force tardif et un peu suspect avec Zazie dans le métro), c’est d’avoir réussi à atteindre, avec une oeuvre aux fondations si savantes, un public très large qui se fichait de la phénoménologie et n’y voyait goutte dans la philosophie existentialiste. Le fil conceptuel n’a surtout pas lieu d’apparaître sur la broderie. Le dessin y suffit.
D’ailleurs, la matière philosophique semble être relativement indifférente. Avec Les Enfants du limon, Queneau fabrique son roman à partir de morceaux de systèmes idéologiques délirants, quadratures de cercle, réformes aberrantes, utopies insoutenables - autant de déchets d’une longue étude sur les fous littéraires qu’il s’était vu refuser par Gallimard et Denoël. Cette Encyclopédie des sciences inexactes dont l’intérêt n’est guère évident, sauf à priser la paranoïa littéraire, alimente le récit, au même titre que la pensée de Husserl avait déterminé l’échafaudage narratif du Chiendent. Encore une fois Queneau éprouve le besoin d’objectiver sa fiction à l’aide de matériaux intellectuels neutres, extérieurs à lui (même si cette encyclopédie fut son oeuvre), brouillant la piste autobiographique qu’il avait suivie dans Odile et Les Derniers jours, déguisant ce qu’il éprouve sous ce qu’il a appris, ce qu’ il ressent sous ce qu’il sait, encageant sa subjectivité écorchée derrière les grilles d’une pensée d’ordre intellectuel - philosophique ou non, peu importe. Comme si sa propre imagination, une fois barré le chemin de l’émotion, avait besoin, pour s’activer, de pensées conceptuelles anonymes, impersonnelles.
De la philosophie ou de l’art de travestir son intimité.
Paru dans Quai Voltaire, 5, 1992.
[1] M. Proust, Essais et articles, Gallimard, « La Pléiade », p. 557-558.
[2] Cf J.-Y. Tadié, Le Roman au XXe siècle, Belfond, chap. V : « Le roman et la pensée ».
[3] M. Proust, Contre Sainte-Beuve, Gallimard, « La Pléiade », p. 253.
[4] J.-Y. Tadié, op. cit., p. 174-175.
[5] M. Proust, op. cit., p. 658.
[6] R. Queneau, Bâtons, chiffres et lettres, Gallimard, « Idées », p. 29.
[7] R. Queneau, Le Chiendent, Gallimard, Folio », p. 188-189. 2. Id., ibid., p.417.
[8] R. Queneau, Le Chiendent, op. cil., p. 206.
[9] M. Heidegger, Qu’esl.ce que la métaphysique ?, Gallimard, p. 29.
[10] Cf C. Simonnet, Queneau déchiffré, Julliard, chap. V.
[11] Cité in E. Souchier, Raymond Queneau, Les contemporains - Seuil, p. 287, n. 62.
[12] R. Queneau, op. cit. p. 374-375.
[13] Ainsi se décrit Queneau dans Les Enfants du limon, Gallimard, p. 314.
[14] S. Freud, Totem et Tabou, Petite Bibliothèque Payot, p. 162-163.
[15] R. Queneau, Saint Clinglin, Gallimard. « L’Imaginaire », p. 110.
[16] S. Freud, Totelll et Tabou, (1). cit., p. 164.
[17] R. Queneau, op. cit., p. 123.
[18] Cf E. Souchier, Raymond Queneau, op. cit., et A. Calame, L’Esprit farouche, Petite Bibliothèque quenienne, n° 2.
[19] Dont Queneau a publié l’Introduction à la lecture de Hegel chez Gallimard.
[20] A. Kojève, « Les romans de la sagesse », Critique, n° 60, mai 1952.
[21] C. Simonnet, Queneau déchiffré, op. cit., p. 109.
Les autres articles de la rubrique
Marbeau, Michel / L’Affaire Weidmann,
Colodiet, François / La République et (...)
Catonné, Jean-Marie / Des idées et (...)
Montenot, Jean / Descartes était-il (...)
Ourednik, Patrik / Ma fille a cinq (...)
Colodiet, François / Carnets de (...)
Montenot, Jean / En attendant (...)
Ourednik, Patrik / Les temps sont (...)
École alsacienne - établissement privé laïc sous contrat d'association avec l'État
109, rue Notre Dame des Champs - 75006 Paris | Tél : +33 (0)1 44 32 04 70 | Fax : +33 (0)1 43 29 02 84