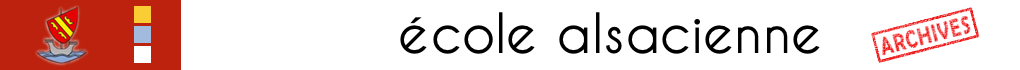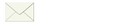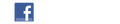Sommaire
Recherche
Connexion
Montenot, Jean / Baudelaire ou les dégoûts créatifs de l’homme penché
« L’odieux y coudoie l’ignoble ; – le repoussant s’y allie à l’infect. Jamais on ne vit mordre et même mâcher autant de seins en si peu de pages ; jamais on n’assista à une semblable revue de démons, de fœtus, de diables, de chloroses, de chats et de vermine. – Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l’esprit, à toutes les puérilités du cœur ; encore si c’était pour les guérir, mais elles sont incurables ». Ainsi parle le critique Gustave Bourdin dans le Figaro du dimanche 5 juillet 1857. Dans le collimateur : Les Fleurs du mal, un petit recueil de cent un poèmes paru fin juin à mille cent exemplaires chez Auguste Poulet-Malassis, un ancien quarante-huitard reconverti en éditeur. La justice du Second Empire, sous l’impulsion du procureur Pinard, peut tenter de faire régner un certain ordre bourgeois, en fait une pruderie bonasse qui tient lieu d’esthétique aux rentiers d’alors. Il faut dire que la tentative de frapper Madame Bovary vient juste d’échouer. Mais cette fois, Pinard tient sa revanche : les Fleurs sont condamnées le 20 août 1857, pour « offense à la morale publique et aux bonnes mœurs ».
« Un livre atroce »
L’auteur de ces « fleurs maladives », Charles Baudelaire, a trente-six ans. Les seuls titres littéraires, ou presque, de cet « Antony attardé », de ce « Jeune-France qui se complait dans son désespoir » [1], sont d’avoir traduit Edgar Allan Poe, un écrivain américain mort depuis peu (1849) et qu’il tient pour son alter ego, d’avoir fait paraître, parfois anonymement, dans des revues confidentielles, quelques fantaisies littéraires et poétiques, et, dans la veine de Diderot, d’avoir publié des Salons, signés Baudelaire Dufaÿs (du nom patronymique de sa mère). Des curiosités esthétiques qui, par la sûreté des jugements de leur auteur en matière de peinture, ont retenu l’attention des esprits les plus perspicaces. Y sont défendus Delacroix, Courbet et on le verra un peu plus tard se faire le défenseur de Manet. En dehors de quelques amis (si ce mot a un sens pour un homme aussi seul que Baudelaire) qui surent discerner le génie sous les masques du personnage, l’auteur des Fleurs du mal est aux yeux de ses contemporains au mieux un amateur d’art éclairé, plus sûrement l’incarnation du dandy s’adonnant au « plaisir aristocratique de déplaire », au pire un « poète en chambre » [2] dont on désespérerait de voir paraître l’œuvre si jamais on l’avait espéré. C’est en tous les cas un excentrique « sans cesse à l’affût de l’originalité, dans ses écrits comme dans ses cravates » [3]. « Sec, osseux, aux yeux petits, vifs, tournoyants, aux lèvres tranchantes se contractant ironiquement, cet homme auquel un commencement de calvitie donne l’air d’un moine rongé par les ardeurs de la chair » [4] n’a plus que dix ans à vivre. C’est le temps que lui laisse « l’affection vérolique », sans doute une syphilis qui œuvre souterrainement et qu’il aurait, si l’on en croit la lettre à sa mère du 6 mai 1861, contractée « étant très jeune » et dont il se serait cru, à tort, « totalement guéri ».
« La France a horreur de la poésie »
Cet homme singulier, déchiré, achève avec « un petit fumet personnel de viande décomposée et de savonnette », précise un rien vachard Marcel Aymé [5], le Romantisme dans notre littérature. Il passe à la postérité grâce à un « livre atroce » (selon l’expression de Baudelaire lui-même), dans lequel il a mis « tout [son] cœur, toute [sa] tendresse, toute [sa] religion travestie, toute [sa] haine » [6]. Et tout son mépris est-on tenté d’ajouter. Témoignage parmi d’autres, cette lettre du 18 février 1866 écrite de Bruxelles et adressée à Maître Ancelle, le « tuteur légal », le notaire en charge depuis décembre 1844, de veiller à ce que Baudelaire, prodigue à l’excès, ne dilapide pas le restant du capital que lui a légué son père. Il s’agit de le contraindre à vivre en honnête rentier des intérêts qu’on en peut tirer – à dire le vrai, cela revenait à vivre chichement, compte tenu de la propension du poète à la dépense et de ses goûts raffinés qui en ont fait une proie d’élection pour les créanciers et les usuriers de tout poils. Dans cette lettre, Baudelaire, dont l’orgueil est plus humilié que jamais – il est à Bruxelles pour donner des conférences qui n’attirent guère de monde et en satisfont encore moins – et dont la maladie renforce l’amertume, vitupère contre cette « France [qui] a horreur de la poésie », qui « n’aime que les saligauds comme Béranger et Musset (sic) ». Il hurle contre « toute la racaille moderne [qui lui] fait horreur ». La suite, mais le bon notaire en a l’habitude, est de la même farine : « Vos Académiciens, horreur. Vos libéraux, horreur. La vertu, horreur. Le vice, horreur. Le style coulant, horreur. Le progrès, horreur. Ne me parlez plus jamais de ces diseurs de riens ». Dans une autre lettre, il concédait avoir « besoin de vengeance comme un homme fatigué a besoin d’un bain… » [7]. Ne pas être un « diseur de riens », transformer la boue de sa vie en or (celui de la poésie), telle fut la quête incessante de ce poète unique, partagé entre le ciel et l’enfer : « Il y a dans tout homme, à toute heure deux postulations simultanées, l’une vers Dieu, l’autre vers Satan » [8]. Baudelaire fut bien le poète de l’entre-deux, le chantre des « limbes » [9] et des franges fangeuses du purgatoire où, à travers les brumes d’un ciel « bas et lourd comme un couvercle », on peut encore deviner les reflets de la lumière rédemptrice du Paradis. Pour ce damné perclus, retenu au sol par les charmes voluptueux du péché, que ce soient les drogues ou les gaupes, le vin, le haschich ou la mulâtresse Jeanne Duval dont la bêtise ornait et conservait la beauté – n’en déplaise « aux aliborons vaniteux » [10] – pour cet homme « aux yeux cernés par la débauche et l’insomnie », pour ce neurasthénique travaillé par l’acédie, rongé de spleen et de mélancolie, et qui, héroïque dans sa déchéance, n’a jamais renoncé à être l’égal des plus grands, c’est l’œuvre à venir qui tient lieu de promesse d’évasion et de quête spirituelle, de seule raison de vivre. C’est bien Baudelaire qui, la nuit, lorsque « la tyrannie de la face humaine a disparu », implore du fond d’une déchéance sinon calculée, en tout cas toujours accompagnée d’une conscience extrêmement lucide : « Seigneur, mon Dieu ! accordez-moi la grâce de produire quelques vers qui me prouvent à moi-même que je ne suis pas le dernier des hommes, que je ne suis pas inférieur à ceux que je méprise » [11]. L’histoire des Fleurs du mal résume la vie de ce poète et les poèmes, longuement mûries, sont autant de médaillons reflétant l’âme multiple du poète, les stations de son itinéraire spirituel.
« Ma vie a été damnée »
Objet de scandale lors de sa publication, Les Fleurs du mal sont donc le principal motif de la gloire posthume du poète. Réédité en 1861, le livre est étoffé d’une nouvelle section et les six poèmes condamnés sont remplacés par 35 nouveaux. Au fond, on ne remerciera jamais assez le procureur Pinard. Sans lui, qui sait si Baudelaire eût jamais remanié son œuvre ? Ce « beau volume complet » qui fait passer « un frisson nouveau » (Hugo) a fait de Baudelaire le poète clé de l’histoire de notre littérature. On l’aura compris, même si la volupté, le rêve, le vertige y côtoient la charogne et la mort, les Fleurs du mal ne sont pas l’œuvre d’un jeune homme exalté en rupture de ban et en mal de provocations. Elles ne sont pas seulement l’œuvre d’un artiste mal à l’aise dans son époque de niaiserie bourgeoise et de foi naïve dans le progrès matériel. Elles sont d’abord l’expression d’un artiste qui se fait une idée si haute de la poésie qu’elle est, à ses yeux, la seule manière de rédimer une existence qu’il sait et, on pourrait presque dire, qu’il a choisie malheureuse : « Je crois que ma vie a été damnée dès le commencement et qu’elle l’est pour toujours » (à sa mère, 4 décembre 1844).
« Il faut aller fusiller le général Aupick ! »
En conflit avec lui-même, avant d’être en conflit avec le monde, Baudelaire porte les stigmates d’une première rupture initiale, celle de l’enfant avec sa mère. La cause occasionnelle en est la mort de son père, une mort qui n’avait pourtant rien de contre-nature quand on sait que ce père, homme du XVIIIe siècle, était de quarante-cinq ans plus âgé que la mère de Baudelaire, Caroline Dufaÿs, jeune orpheline, et qu’il l’avait épousé en secondes noces. À la mort de ce père, ancien prêtre défroqué et embourgeoisé, devenu fonctionnaire aisé et peintre, quoique « détestable artiste » [12], Charles n’a que six ans et, si on en juge par une confession tardive, un intense amour le lie à sa mère : « J’étais toujours vivant en toi, tu étais uniquement à moi. Tu étais à la fois une idole et un camarade ». La meurtrissure fondamentale est en fait le remariage rapide de Mme Baudelaire avec le futur Général Aupick, vécu comme une trahison par l’âme sensible et solitaire du petit garçon. Il ne faut pas être grand clerc pour reconnaître, dans le premier poème des Fleurs du mal, intitulé « Bénédiction », Mme Aupick sous les traits de cette « mère épouvantée et pleine de blasphèmes » [qui] « crispe ses poings vers Dieu, qui la prend en pitié » et qui déclare : « Ah ! que n’ai-je mis bas tout un nœud de vipères / Plutôt que de nourrir cette dérision ! / Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères / Où mon ventre a conçu mon expiation ». L’intrus, Jacques Aupick devient dans l’esprit du poète le premier responsable du naufrage douloureux de son existence, celui qui a gâché les « verts paradis des amours enfantines ». Bref, même s’il prend garde à ne pas se montrer à lui « dans tout son laid » [13], Baudelaire ne peut souffrir ce beau-père qu’il affecte d’abhorrer et qui finit par le lui rendre. Renvoyé du lycée, mais ayant réussi son bac, sa vie d’étudiant commence par l’affirmation de sa vocation littéraire et quelques débauches. Sa relation avec Sarah la Louchette qui « [mettrait] l’univers dans [sa] ruelle » et dont la « beauté ne fleurit que dans [son] triste cœur », le décore d’une première « maladie secrète », en fait une blennorragie constatée en novembre 1839. Réminiscence probable de cet épisode, ce portrait idéalisé des Fleurs : « Une nuit que j’étais près d’une affreuse Juive / Comme au long d’un cadavre un cadavre étendu, / Je me pris à songer près de ce corps vendu / À la triste beauté dont mon désir se prive… » [14]. La tentative de « rattraper » le jeune Charles en l’envoyant en croisière forcée dans les mers du sud (juin 1841) s’avère un échec. Loin de le dissuader de s’engager dans une carrière littéraire, forcément aléatoire et peu susceptible d’apporter à Caroline Aupick les satisfactions qu’une mère est en droit d’espérer de son fils, l’équipée dans l’hémisphère sud, décidée par un conseil de famille, ne donne guère de résultats, sinon d’inspirer au poète naissant quelques poèmes promis à la célébrité, comme l’Albatros, allégorie du poète humilié par la société des baffreurs et des ricaneurs, « exilé sur le sol au milieu des huées » [15]. Ou encore la fantaisie courtoise : À une dame créole où s’affirme son penchant pour l’exotisme. Mais Baudelaire n’est décidemment pas un écrivain voyageur. S’il a la phobie du domicile fixe, il n’en est pas moins demeuré pour l’essentiel un « flâneur parisien » comme l’atteste Le Spleen de Paris titre des Petits poèmes en prose parus après sa mort pour « faire pendant aux Fleurs du mal », et qui marquent « un commencement absolu » [16] dans l’ordre des lois de la création littéraire. Ses invitations au voyage sont toutes de rêveries et d’extases poétiques. Seule l’âme du poète appareille et non son corps, chaque jour un peu plus dartreux. Nul besoin de rafiots, ni de capitaine au long cours radotant sur la dunette des exhortations de commande que le jeune homme mélancolique ne saurait entendre. Le vin, la poésie, les drogues, la vertu même feront office de navire. La bohême et l’errance parisienne, que l’entrée dans ses droits d’héritiers a rendues possible, ont conduit sa famille à exiger qu’on le protége contre lui-même par sa mise sous tutelle. À moitié par désespoir, à moitié pour protester contre ce qu’il vit comme une humiliation, Baudelaire tente même, mollement, de se suicider (juin 1845) : « Je me tue parce que je suis inutile aux autres » [17]. Cela ne l’empêche pas d’écrire un peu plus tard dans Mon Cœur mis à nu : « être un homme utile m’a paru toujours quelque chose de hideux » [18]. Tous ces événements n’ont guère amélioré les relations de Charles avec Aupick promu entre-temps général. Et personne ne s’étonne que, pendant sa brève période d’engagement politique, son « ivresse en 1848 », Baudelaire ait pu crier sur les barricades : « Il faut aller fusiller le général Aupick ! ». Le coup d’État du 2 décembre achève de le « dépolitiquer » complètement.
« Sentiment de destinée éternellement solitaire »
Sans illusions politiques, Baudelaire n’en a guère davantage du côté de sa vie sentimentale. En fil d’Ariane, une tumultueuse relation avec Jeanne Duval (ou Jeanne Lemer, alias Mlle Prosper), rencontrée en 1842. La fameuse Vénus noire est bien cette « [b]izarre déité, brune comme les nuits, / Aux parfums mélangé de musc et havane, / Œuvre de quelque obi, le Faust de la savane, / Sorcière au flanc d’ébène, enfant des noirs minuits » [19]. On compte aussi quelques actrices et demi-mondaines comme Marie Daubrun (que lui souffle Banville). Et au nombre des muses plus présentables, cette Mme Sabatier, surnommée la « Présidente » qui tenait salon du côté de la barrière de Montmartre, aujourd’hui place Pigalle. Elle inspire directement dix ou onze pièces des Fleurs du mal dont À celle qui est trop gaie. Cette âme sœur demeure l’égérie du poète tant que leur relation demeure platonique. Le charme est rompu lorsqu’ils passent à l’acte (le 30 août 1857). Dans la lettre qu’il lui écrit le jour même, le poète séducteur frise alors la muflerie : « Et enfin, enfin, il y a quelques jours, tu étais une divinité, ce qui est si commode, ce qui est si beau, si inviolable. Te voilà femme maintenant ». Il faut dire qu’au chapitre des femmes, Baudelaire ne brille pas par son aménité : « La femme est le contraire du dandy. / Donc elle doit faire horreur. / La femme a faim, et elle veut manger ; soif, et elle veut boire./ Elle est en rut et elle veut être foutue. / Le beau mérite ! / La femme est naturelle, c’est-à-dire abominable. Aussi est-elle toujours vulgaire […] » [20]. Ce n’est donc pas avec elles que Baudelaire pouvait rompre avec le « sentiment de solitude » qui l’a marqué « dès son enfance [,] malgré la famille, et au milieu de [ses] camarades souvent », ce « sentiment de destinée éternellement solitaire » [21]. De toute façon, « il n’y a de grand parmi les hommes que le poète, le prêtre et le soldat ». Autrement dit : « L’homme qui chante, l’homme qui sacrifie et se sacrifie. Le reste est fait pour le fouet. » [22]. Narcisse autolâtre plein, voire débordant de lui-même, Baudelaire est surtout malade de sa propre lucidité. Il adhère trop à lui-même pour s’en évader, pas assez pour s’y perdre : « Tête-à-tête sombre et limpide / Qu’un cœur devenu son miroir ! » [23]. Oui, mais quand ce miroir est celui d’un artiste, il s’y joue bien plus qu’une destinée individuelle, bien davantage le jeu narcissique du « Dandy [qui] aspire à être sublime sans interruption [et qui vit et dort] devant son miroir » [24].
« Sois toujours poète, même en prose »
« Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l’écurie, c’est-à-dire faits pour exercer ce qu’on appelle des professions » [25]. Dans le cas de Baudelaire, pas d’autre vocation possible que celle de poète. Mais on ne saurait limiter son génie aux chants douloureux d’un être qui tente d’extraire la « beauté du Mal » [26] et qui oscille, depuis l’enfance, « entre l’horreur de la vie et l’extase de la vie » [27]. On se doit d’y ajouter la figure du penseur original, car le poète est « naturellement critique ». Original, il ne l’est certes pas dans l’idéal de la synthèse des arts, qu’il reprend des romantiques, mais bien dans la raison qu’il en donne. Si la peinture, la musique et la poésie se répondent, c’est que tous les arts correspondent en fait à un niveau supérieur, inaccessible aux esprits réalistes – spécialement aux matérialistes, ces « abolisseurs d’âme » [28] – comme d’ailleurs aux idéalistes naïfs. Baudelaire s’en prend à « l’erreur positiviste » de ceux qui veulent « se représenter les choses telles qu’elles sont ou bien seraient, en supposant que je n’existe pas » [29]. Sa poétique est résolument une poétique spiritualiste, une poétique de l’âme, celle d’un moi à la fois vaporisé et centralisé [30] : « Qu’importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m’a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis ». L’essentiel tient dans la capacité de l’artiste de se tenir à la hauteur de « cet admirable, [de] cet immortel instinct du beau qui nous fait considérer la terre et ses spectacles comme un aperçu, comme une correspondance du ciel […] C’est à la fois par la poésie et à travers la poésie, par et à travers la musique que l’âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau » [31]. Le romantisme, version Baudelaire « en contradiction évidente [avec] les œuvres de ses principaux sectaires », est « intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l’infini, exprimées par tous les moyens que contiennent les arts » [32]. Il se confond avec « l’art moderne ». Il lui revient de « créer une magie suggestive contenant à la fois l’objet et le sujet, le monde extérieur à l’artiste et l’artiste lui-même » [33]. Tout le travail de l’artiste ou du poète, c’est tout comme, consiste à « s’aventurer dans cette forêt de symboles » qu’est la Nature, à cultiver cette faculté supérieure son imagination. « Tout l’univers n’est qu’un magasin d’images et de signes auxquels l’imagination donnera une place et une valeur relatives ; c’est une espèce de pâture que l’imagination doit digérer et transformer. Toutes les facultés de l’âme humaine doivent être subordonnées à l’imagination qui les met en réquisition toutes à la fois » [34].
« Le beau est toujours bizarre »
Saisir le Beau, atteindre l’Idéal, la belle affaire ! N’est-ce pas là au fond l’ambition de tout artiste, classique ou moderne ? Soit, mais là encore, il faut s’entendre sur les mots. Pour Baudelaire, le Beau renvoie à une « nouvelle manière de sentir » à cent lieues du beau des « professeurs-jurés » qui prétendaient en fixer les règles immuables, abîmant avec assurance et aplomb toute beauté dans « une vaste unité, monotone et impersonnelle comme l’ennui et le néant » [35]. Le Beau exige la variété, l’étonnement, l’insolite, bref, « le beau est toujours bizarre [non pas] volontairement, froidement bizarre, car dans ce cas [il] serait un monstre sorti des rails de la vie ». Baudelaire soutient que le beau « contient toujours un peu de bizarrerie, de bizarrerie naïve, non voulue, inconsciente ». C’est même cette bizarrerie « qui le fait être particulièrement le Beau, c’est son immatriculation, sa caractéristique ». De même, « l’Idéal [baudelairien] n’est pas cette chose vague, ce rêve ennuyeux et impalpable qui nage au plafond des académies ; un idéal, c’est l’individu redressé par l’individu, reconstruit et rendu par le pinceau ou le ciseau à l’éclatante vérité de son harmonie native » [36]. Gageons que si l’attitude originelle de Baudelaire fut celle d’un « homme penché », l’expression est de Sartre [37], son œuvre n’a pas qu’un peu contribué à le redresser sinon à ses propres yeux du moins à ceux de la postérité.
Paru dans Lire, XX, 2006
[1] Robert Kopp, Baudelaire, Le Soleil noir de la modernité, Découverte Gallimard, 2004, p. 73.
[2] Claude Pichois, Jean Ziegler, Baudelaire Fayard, réed. 2005, p. 436.
[3] Jean-François Vaudin, Gazetiers et Gazettes – Histoires critiques et anecdotiques de la Presse Parisienne, 1858-1860.
[4] Firmin Maillard, Le Présent, 2 juillet 1857, cité par Pichois-Ziegler, p.436.
[5] Marcel Aymé, le Confort intellectuel, ch. V, Flammarion, 1949.
[6] Lettre à Ancelle, 18 février 1866.
[7] Lettre à sa mère, 5 juin 1863.
[8] Baudelaire, Mon cœur mis a nu XI, O. C. La Pléiade, t. I, p. 682.
[9] C’est là le second titre que Baudelaire avait envisagé en 1848 pour les Fleurs du mal. Titre « mystérieux » qui faisait suite à un « titre pétard », Les Lesbiennes. Une anecdote, rapportée par Asselineau, l’un des rares vrais amis de Baudelaire, stipule que le titre retenu finalement lui avait été soufflé en 1855 par Hyppolite Babou, un de ses hommes de bar, compagnon de beuverie, mais aussi critique et romancier de talent.
[10] Baudelaire, Choix de maximes consolantes sur l’amour, paru en mars 1846 dans Le Corsaire-satan, O. C., Le Seuil, p. 264.
[11] Baudelaire, Le Spleen de Paris, « À une heure du matin », O. C. La Pléiade, t. I, p. 287.
[12] Baudelaire, Lettre à sa mère du 30 décembre 1857.
[13] Baudelaire, Lettre du mardi 16 juillet 1839.
[14] Baudelaire, Spleen et Idéal, XXXII, Les Fleurs du mal, édition 1857, O. C. La Pléiade, t. I, p. 34.
[15] Baudelaire, L’Albatros, Spleen et Idéal, II, Les Fleurs du mal, édition 1861, O. C. La Pléiade, t. I, p. 9.
[16] Georges Blin, Le Sadisme de Baudelaire, Corti 1948.
[17] Lettre de 1845.
[18] Baudelaire, Mon cœur mis a nu, O. C. La Pléiade, t. I, p.679.
[19] Baudelaire, Sed non satiata, Les Fleurs mal, O. C. La Pléiade, t. I, p. 28.
[20] Baudelaire, Mon cœur mis à nu III, O. C. La Pléiade, t. I, p. 677.
[21] Baudelaire, Mon cœur mis à nu VII, O. C. La Pléiade, t. I, p. 680.
[22] Baudelaire, Mon cœur mis à nu XXVI, O. C. La Pléiade, t. I, p. 693.
[23] Baudelaire, L’irrémédiable, Les Fleurs mal, O. C. La Pléiade, t. I, p. 80.
[24] Baudelaire, Mon cœur mis à nu III, O. C. La Pléiade, t. I, p. 678.
[25] Baudelaire, Mon cœur mis à nu XIV, O. C. La Pléiade, t. I, p. 684.
[26] Projet de préface aux Fleurs du mal.
[27] Baudelaire, Mon cœur mis à nu XL, O. C. La Pléiade, t. I p. 703.
[28] Baudelaire, Mon cœur mis à nu XIV, O. C. La Pléiade, t. I, p.684.
[29] Baudelaire, Salons de 1859, Baudelaire, O. C., Le Seuil, p. 400.
[30] Baudelaire, Mon cœur mis à nu I, O. C. La Pléiade, t. I, p. 676.
[31] Baudelaire, Notes nouvelles sur Edgar Poe, III et IV, 1857, Baudelaire, O. C., Le Seuil, p. 352.
[32] Baudelaire, Salons de 1846, II « Qu’est-ce que le romantisme ? », Baudelaire, O. C., Le Seuil, p. 230.
[33] Baudelaire, L’art philosophique, 1860-1864, Baudelaire, O. C., Le Seuil, p. 424.
[34] Baudelaire, Salons de 1859, IV « Le gouvernement de l’imagination », Baudelaire, O. C., Le Seuil, p. 399.
[35] Baudelaire, Exposition universelle de 1855, Baudelaire, O. C., Le Seuil, p. 362.
[36] Baudelaire, Salons de 1846, VII, Baudelaire, O. C., Le Seuil, p. 245.
[37] Sartre, Baudelaire, 1947, Folio, p. 33.
Les autres articles de la rubrique
Marbeau, Michel / L’Affaire Weidmann,
Colodiet, François / La République et (...)
Catonné, Jean-Marie / Des idées et (...)
Montenot, Jean / Descartes était-il (...)
Ourednik, Patrik / Ma fille a cinq (...)
Colodiet, François / Carnets de (...)
Montenot, Jean / En attendant (...)
Ourednik, Patrik / Les temps sont (...)
École alsacienne - établissement privé laïc sous contrat d'association avec l'État
109, rue Notre Dame des Champs - 75006 Paris | Tél : +33 (0)1 44 32 04 70 | Fax : +33 (0)1 43 29 02 84