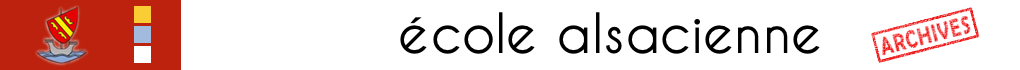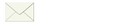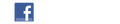Sommaire
Recherche
Connexion
Antonin Sené : Tristes Sires
Année 2002/03 – Lycée
Tout a commencé un 24 janvier 1351, à Maupertuis. Moi, Archambaud de Poitillon, j’y étais. Je me suis battu pour mon Roi et j’ai survécu à cette débâcle. Beaucoup d’entre nous y ont péri mais Dieu a voulu que je vive pour voir mon royaume se faire dépecer par les anglais auxquels je voue une haine mortelle.
Je ne sais pourquoi, au crépuscule de ma vie, j’ai décidé d’écrire ce qui s’est passé ce jour-là. Peut-être poussé par le remord et la honte, j’ai choisi de dire la vérité sur cette bataille même si pour cela je dois entacher la réputation de certains seigneurs. Aujourd’hui je crains fort que la France ait été touchée d’une blessure mortelle qui annonce un sinistre avenir.
La bataille se passa à l’aube et comme un disque de rubis, le soleil s’éleva lentement à l’horizon, les accidents du paysage, les rochers, les prés ensevelis dans l’ombre réapparurent, et les arbres situés sur les hautes et belles rondeurs de la colline dessinèrent leurs formes tordues sous le renouveau de ses feux.
Une légère brise siffla dans l’air, les oiseaux chantèrent, la vie se réveilla dans toutes les vallées ainsi que dans le bourg de Maupertuis.
Il était niché sur un rocher de calcaire que l’on aurait dit tombé en avant des collines escarpées. Il surplombait une large cuvette et dominait de vertes forêts. Maupertuis, découpé sur le ciel, ceint dans ses remparts de bonnes pierres grises que doraient les rayons du soleil, montrant ses clochers, les tours de son château, la haute structure de l’église au clocheton brillant, et tous ses toits de tuiles serrés les uns contre les autres, ressemblait aux miniatures des villes orientales dans les incunables. Une jolie petite ville sans aucun doute mais aussi un cimetière géant ; combien d’entre nous y gisent ? Pourquoi un tel massacre ? Je ne sais point mais lorsque l’armée de Jean II dit Jean le Bon est apparue, en avant de Maupertuis, se tenant déployée en bataille, les fanions frissonnant au bout des lances sur près d’un demi-lieu de front, la vie était encore paisible et la fierté pouvait encore gonfler nos cœurs. La rivière qui serpentait dans la cuvette luisait comme un bouclier bien graissé entre les larges champs cultivés et les prairies. Les forêts descendaient de leurs collines jusqu’au niveau des pâturages ou des paysans étaient occupés à traire des vaches et d’autres à couper du bois pour le restant de l’hiver.
Personne ne semblait remarquer la présence des Anglais sur un monticule en plein milieu de la plaine. Les paysans les ignoraient ; l’armée française riait d’avance de l’affrontement qui allait se dérouler, sûre de leur régler leur compte. Le Maréchal de Clermont, arrivant de Tours venait de faire son apparition à l’opposé de la troupe du Roi. Les Anglais étaient coincés, acculés, battus d’avance. C’était sans compter sur leur chef, le fils d’Edouard III, Prince de Galles, Prince d’Aquitaine, Dur de Cornouaille, Comte de Chester, Seigneur de Buscaye… Le Pape et le Roi étaient les seuls hommes qu’il tenait pour supérieurs. Toutes les autres créatures, à ses yeux, n’étaient que des inférieurs, plus ou moins bas sur l’échelle de son dédain. Il avait le don de commander, c’est certain, et le mépris du risque. Il était endurant, il bravait la mort et gardait la tête claire face au danger. Il était grand dans le succès et couvrait et couvrait de dons ses amis. Edouard de Woodstock (de son vrai nom), fils d’Angleterre avait déjà un surnom, le Prince Noir, qu’il devait à l’armure d’acier bruni qu’il affectionnait et qui le rendait remarquable parmi les chemises de mailles toutes brillantes et les cottes d’armes multicolores des chevaliers qui l’entouraient. C’est le seul Anglais que j’ai jamais respecté. Et que Dieu me pardonne, comme j’aurais aimé qu’il soit français et se batte pour le drapeau fleurdelisé.
Jean II, roi de France, au centre de son armée avait croisé ses mains gantées de fer sur le pommeau de sa selle. Il était tête nus. Un écuyer, derrière lui, portait son heaume. Le mois d’octobre avait été bon pour lui ; il avait fait tombé une à une toutes les forteresses prises par le Prince Noir. Pourtant s’il était un guerrier violent, il n’était pas grand stratège. Il lançait ses expéditions sans ordres, un jour au nord, le lendemain à l’ouest, selon l’inspiration du moment. Il menait un vie sauvage, dangereuse, frénétique, qui lui plaisait. Il se réjouissait de la peur qui naissait à son approche, mais ne voyait pas la haine qu’il laissait sur ses pas. Trop de corps pendus aux branches, trop de décapités, trop d’enterrés vifs au milieu e grands rires cruels, trop de filles violées qui gardaient sur la peau les marques des cottes de maille, trop d’incendies jalonnaient ses routes.
Le Maréchal Clermont, resplendissant de beauté dans sa belle armure dorée se détacha de son régiment et caracola sur son grand étalon noir en direction de Jean II. C’est alors qu’éclata la discorde qui nous fit perdre la bataille.
Clermont posa pied à terre devant son Roi, le baisa puis il dit avec un fort accent gascon : « Sire, si vous voulez vraiment avoir les Anglais à votre merci, que ne les laissez-vous s’épuiser par défaut de vivres ? Car leur position est forte, mais ils ne la soutiendront guère quand ils auront le corps faible. Ils sont de toute part encerclés, et s’ils tentent une sortie par la seule issue où nous pouvons nous-même les forcer, nous les écraserons sans peine. Puisque vous avez attendu une demi-journée, que ne pouvez-vous attendre une ou deux autres, d’autant qu’à chaque moment nous nous grossissons des retardataires qui nous rejoignent ? »
Et le connétable, chef des armées du Roi, intervint dans la discussion et appuya les dires de Clermont :« le Maréchal dit bien, nous avons tout à gagner et rien à y perdre ! »
La querelle des maréchaux, il fallait bien qu’elle éclatât. Mais était-ce le moment le mieux choisi ? Clermont n’était pas homme à prendre si gros outrage en plein visage sans réagir et dans son mépris pour Audrehem, il s’exclama :
« Vous n’êtes aussi hardi aujourd’hui mon Maréchal, que parce que vous vous réfugiiez derrière la croupe de mon cheval lors de la bataille ! »
Là-dessus, je le vis repartir vers les cavaliers qu’il devait emmener à l’assaut et donner l’ordre d’attaquer son épée bien haut dans le ciel dont l’éclat étincelait au-dessus des douces et vertes prairies.
Ce fut la catastrophe. Audrehem, furieux, se fit hisser en selle et imita Clermont sous les yeux du Roi qui, sans en avoir donné l’ordre, constata pourtant que la charge était lancée, non point groupée comme il en avait décidé, mais en deux escadrons séparés qui semblaient moins se soucier de rompre l’ennemi que de se distancer ou de s poursuivre.
Alors le Roi, désemparé, fit sonner l’attaque. Les cors mugirent. Les Anglais restaient en attente tenant leur position sur le monticule. Au signal, toutes les bannières françaises s’élancèrent, les hommes d’armes, à pied, pataud, alourdis par 50 à 60 kilos de ferraille commencèrent à avancer dans les champs vers le chemin où s’engouffrait déjà la cavalerie.
Là-haut, la terre se mit à trembler. Les cœurs se serrèrent d’angoisse. Les archers gallois, un genoux en terre, derrière leurs pieux pointus, attendant l’ordre de tirer, regardèrent puis visèrent la troupe du Maréchal Clermont, dont je faisais partie, charger la bannière du comte de Kent, en tentant de faire une brèche. Ce fut horrible, les fameux archers longs gallois décochèrent leurs flèches qui vinrent briser notre charge ; la tombée fut atroce. Les soldats autour de moi chancelèrent avant de chuter, se faisant écraser par le reste de la troupe qui tentait tout de même de les éviter. Dans la confusion, nous ne pensâmes pas à regarder devant nous. Et voilà comment nous arrivâmes en pleine vitesse sur la herse de pieux gallois où nos chevaux incontrôlables s’empalèrent dans des hennissements de douleur et par-dessus laquelle je fus projeté à terre.
Immobilisés et impuissants dans nos armures nous ne pouvions bouger, nous vîmes sortir d’à travers les rangs des archers impassibles, une centaine de fantassins armés de fourches et de gaudenharts, ces terribles armes avec trois crocs dont le plus long sert à saisir le chevalier par la cotte de maille ou par la chair et à le jeter à bas de sa monture. Je tentais d’enlever mon armure quand j’aperçus Clermont agenouillé se faisant poignardé par trois Anglais qui se mirent à le dépecer de ses biens. Tout le monde criait et baignait dans le sang des autres. Par un miracle, je réussis à enlever mon armure et à rejoindre un groupe de Français qui se défendait vaillamment près de la palissade. Les secondes nous parurent une éternité avant de voir passer la charge d’Audrehem. Nous espérions qu’il viendrait nous aider. Mais assoiffé de victoire, il donna droit vers les Anglais du duc de Warwick dont les archers ne lui firent pas meilleur parti. Je le vis à son tour s’écrouler de son cheval, une flèche dans la cuisse. Quant au Connétable, embourbé au milieu de la côte, il n’était d’aucune aide et ce fut la dernière fois que je le vis vivant dans son armure dorée.
La bataille avait été mal engagée mais cela ne faisait encore que quelques centaines d’hommes repoussés ou tués sur plusieurs milliers qui avançaient encore lentement vers les positions anglaises. Cela, nous ne le sûmes qu’après. Voyant Audrehem nous ignorer, nous reculâmes, prenant à rebours le chemin par lequel nous étions arrivés. Hélas, nous déboulâmes au milieu des troupes de la bannière Orléanaise. Ce fut un choc désorganisateur. Nos quelques montures encore vivantes donnèrent dans les leurs qui se cabrèrent, désarçonnant leurs cavaliers, puis renversant comme des pièces d’échecs leurs compagnons qui s’en venait à pied. Seules quelques dizaines tombèrent mais ce fut assez pour semer la panique dans les rangs de la bannière, les derniers ne sachant pas pourquoi les premiers refluaient ni sous quelle poussée. Et voilà comment la panique s’empara de milliers de soldats.
Le régiment du Dauphin, lui, poursuivait son progrès. Les premiers rangs s’engagèrent dans le goulot qui avait été si funeste à Clermont. Ils buttèrent sur les chevaux et les hommes abattus. Puis ils furent accueillis par les mêmes nuées de flèches, tirées de derrière les palissades qui avaient déjà tué leurs compagnons. Le Dauphin et sa troupe étaient à pied, comme l’avait exigé son père. Mais voilà, quand on est avec plusieurs centaines de cuirasses devant soi et que votre champ de vue se limite à une fente dans un casque, on ne voit pas sur les ailes. Le Duc de Warwick le savait, aussi bien que vous et moi. Le voici alors, non content d’avoir détruit la bannière d’Audrehem fondant avec son armée de cavaliers sur le flanc de la troupe du Dauphin. Incapables de résister à la charge, au moins un quart des hommes périrent sous le premier assaut. Quel comble de voir les Anglais se battre à cheval alors qu’ils tirent leur renommée des combats à pied. Dès qu’ils virent les troupes françaises démontées, ils attaquèrent de nouveau. Ils produisirent exactement le même désastre dans la bannière du Dauphin que celui qui avait déjà frappé d’Orléans.
Il ne restait plus que l’armée du Roi mais elle était encore plus grande à elle toute seule que celle des Anglais. Le Roi était fort attristé de la conduite des deux autres bannières mais il ne doutait pas de l’issue de la bataille. Étrangement Jean II ne changea en rien son plan de bataille. Ce fut une erreur tragique. Les Anglais bien contents de ne pas modifier leur tactique, chargèrent aussitôt. Ils se précipitèrent sur lui comme des démons, lances basses, rompant du premier coup son front de bataille.
Alors Jean II perdit son sang froid. Il cria : « A moi Artois, à moi Bourbon » et encore : « A moi bourgogne, à moi le Berry ». Mais ils s’étaient tous rendus. Il ne restait que lui sur le champ de bataille. Taillant comme un bûcheron dans une forêt d’acier, il ne sentait rien, ni fatigue ni effroi, seulement la rage qui l’aveuglait plus encore que le sang qui lui voilait son œil gauche. Il les vit tous tomber, l’un après l’autre : Clermont étripé par des gueux ; le connétable écrasé par une charge, Audrehem fait prisonnier et le brave Charny, porteur de l’oriflamme transpercée d’un coup de lance.
À ses côtés, son plus jeune fils lui criait « A gauche, père ! Père, gardez vous à gauche ! Père, gardez vous à droite ». Soudain Jean II fut entouré de toute part. Plus aucun blason français pour le défendre encore. Mais sa rage le rendait imprenable. Il fendait l’air de son arme, à droite, à gauche. L’ennemi voulait le prendre vivant mais comment ? Alors, arriva un géant qui lui asséna un coup terrible sur l’épaule. Le Roi vacilla, se tint encore debout quelques secondes, puis posa un genou à terre et s’écroula en même temps que son royaume. Triste fin pour un grand roi et pour un grand royaume. Le Roi est tombé. Sa couronne s’est brisée, laissant son pays plongé dans lez déshonneur et la douleur de la défaite. Maudits soient les seigneurs qui nous ont conduit au désastre ; les tristes sires qui, par leur vanité, ont fait ressembler ma vie et celles de mes compagnons à un long tunnel où la mort, après tant d’années, nous apparaît comme la seule délivrance qui nous fasse encore envie.
Les autres articles de la rubrique
Candice Djorno : Le jour où j’ai (...)
Tangui Reltgen : Amitié mortelle
Pauline Laznik-Penot : La Note (...)
École alsacienne - établissement privé laïc sous contrat d'association avec l'État
109, rue Notre Dame des Champs - 75006 Paris | Tél : +33 (0)1 44 32 04 70 | Fax : +33 (0)1 43 29 02 84